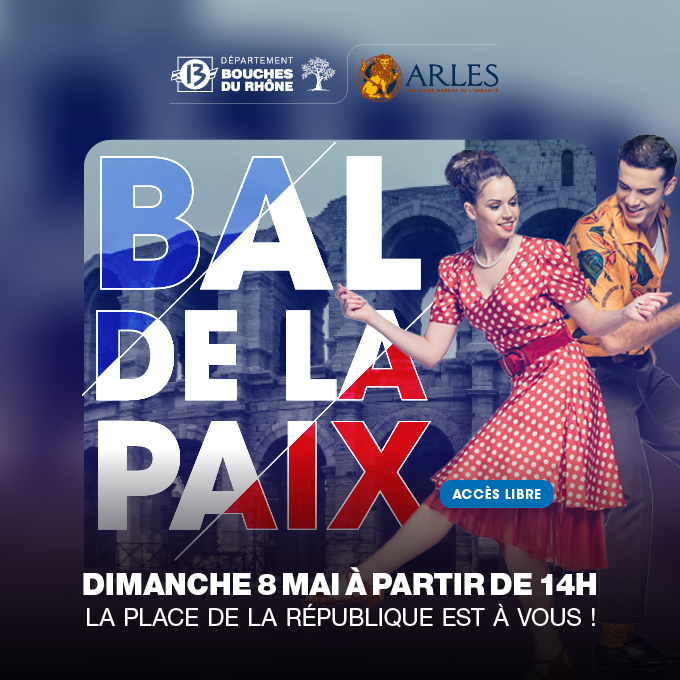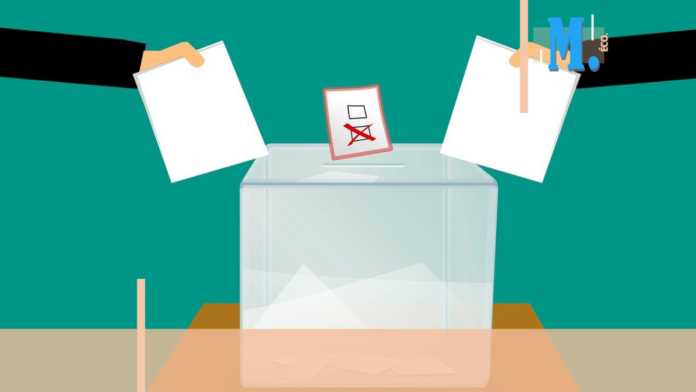Du 5 au 9 mai 2022, le Salon méditerranéen d’art contemporain et d’art abstrait offre la possibilité au public de rencontrer 200 artistes et leurs 4 000 œuvres d’art uniques avant-gardistes. Une pléiade de peintres, sculpteurs, photographes, performeurs et autres artistes de design, de street et de pop art, de vintage et de recycl’art seront au rendez-vous, qui aura lieu au parc Jourdan, à Aix-en-Provence. L’occasion de découvrir des artistes, les rencontrer et les soutenir, à travers une programmation détaillée : entre concerts de salsa, de jazz et de funks, des ateliers artistiques seront organisés, ainsi que des soirées privées, des conférences et des performances. Le tout dans une ambiance festive printanière !
La start-up qui promet – « J’aime mon resto », le numérique au service des restaurateurs
« Regarder est devenu aussi important que manger ». Cette phrase qui claque comme un constat vous semble étonnante ? Aujourd’hui, neuf clients sur dix consultent Internet pour choisir un restaurant. Une pratique que la crise sanitaire a bel et bien installée, et qui ne fait que s’accélérer. Face à cela, un grand nombre de restaurateurs se retrouvent démunis : manque de temps pour promouvoir leur établissement sur les réseaux sociaux, ou tout simplement, manque de méthode, de connaissance, ou d’appétence ! La start-up marseillaise « J’aime mon resto » veut épauler les restaurateurs de la région (principalement) pour leur permettre de s’adapter à ce nouveau monde.
Si le territoire marseillais est sans doute parvenu, plus que d’autres, à tirer son épingle du jeu après les catastrophes économiques dues à la crise sanitaire, les quelque 6 000 restaurateurs des Bouches-du-Rhône en ressentent encore les effets. Difficile de remonter la pente, même après des mois de perfusion. Entretemps, les habitudes des clients ont elles aussi changé : le « tout, tout de suite » est à la mode.
le « tout, tout de suite » est à la mode
« Il y a bien eu un effet avant/après covid, souligne Karim Ben Amar, fondateur d’Oxyne, l’entreprise à l’origine du projet « J’aime mon resto »; des restaurants qui se maintenaient auparavant de façon « normale » se sont rendu compte qu’ils ne pouvaient plus exister de la même façon. C’est simple, auparavant, on disait qu’il y avait trois éléments essentiels pour un établissement : un, l’emplacement ; deux, l’emplacement ; trois, l’emplacement, explique avec un sourire notre interlocuteur. Aujourd’hui, même des établissements idéalement situés n’ont pas une garantie de fréquentation importante. »
Des restaurateurs (de toutes les générations) qui connaissaient les clients par leur prénom ne voyaient souvent aucun intérêt à communiquer pour les réseaux sociaux. Or, pas de secret : dans le secteur de la restauration particulièrement, le numérique, après le covid, s’est clairement imposé en maître.

A l’origine de l’aventure, une initiative solidaire
Karim Ben Amar vient du monde de la restauration ; il a notamment été directeur des opérations et du développement commercial chez Pernod Ricard à Marseille pendant cinq ans (et a appartenu au groupe pendant plus de 15 ans). En 2018, il crée Oxyne, une entreprise qui a pour but de relier des start-ups innovantes qui ont des solutions spécialisées dans le marché de l’alimentaire, avec des grands groupes en recherche d’innovation.
comment poursuivre le soutien aux restaurants ?
En mars 2020, au début du confinement, le groupe Unilever demande à l’entreprise de piloter pour lui une plateforme solidaire : à ce moment-là en effet, les restaurateurs sont coupés du monde, et n’ont presque plus de contact avec leurs clients. « Cette initiative prend une ampleur à laquelle on ne s’attendait pas », observe Karim Ben Amar. En quelques mois, des centaines, puis des milliers de restaurateurs sont inscrits sur la plateforme. L’idée est de chercher des financements pour ces restaurants, pour que ces derniers bénéficient d’une communication gratuite, d’un lien avec leurs clients.
Fin 2020 pourtant, il faut bien se résoudre à « débrancher la prise » de cette initiative solidaire. La question se pose alors : comment poursuivre le soutien à tous ces restaurants ? Unilever accepte de céder ses droits, et les partenaires réunis autour de la table (parmi lesquels Métro), décident de peaufiner le projet.
La naissance d’une start-up à Marseille
En octobre 2021 est lancée une initiative 100% marseillaise, qui s’appuie sur une série de questions posées aux établissements de la ville. « En interrogeant les restaurateurs, on se rend compte que ces derniers déploraient bien avant le covid de ne pas avoir de solutions d’accompagnement humain qui soient personnalisées et locales », souligne Karim Ben Amar.
l’idée est d’établir un diagnostic pour chaque restaurant
L’idée d’origine est d’établir un diagnostic pour chaque restaurant, de faire le point sur toutes leurs formes de communication en ligne : site internet, réseaux sociaux… Cela leur permet de savoir précisément ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Un fois ce diagnostic établi, « J’aime mon resto » leur propose les services d’un freelance qui va les suivre au quotidien : des jeunes du territoire qui veulent se lancer dans une activité en numérique travaillent à leur service.
Grâce au projet, les restaurateurs comprennent le monde du numérique dans lequel ils doivent désormais évoluer, l’apprivoisent, et deviennent indépendants, notamment grâce à une application conçue pour eux. Sur celle-ci, ils peuvent suivre facilement les interactions des internautes avec leurs publications, les progressions des vues etc.
Une « brigade digitale » qui a fait ses preuves
La « brigade digitale de proximité » (une petite dizaine de personnes pour l’instant), comme l’appelle Karim Ben Amar, fonde son efficacité sur l’écoute, l’échange et l’analyse. Le système a d’ores et déjà été testé auprès d’une quinzaine de restaurateurs marseillais, et va s’étendre dans les prochains mois. Des partenaires de taille ont rejoint le projet, parmi lesquels la Métropole, la ville de Marseille et l’Office de Tourisme. « J’aime mon resto » représente un modèle d’économie collaborative dont Marseille et sa région (et les 30 000 salariés du secteur de la restauration) ont besoin.
Raphaëlle PAOLI
Retour de match – Feyenoord/OM (3-2) : pas à la hauteur de l’évènement
On nous avait promis un football offensif côté hollandais, on a été servi. Le stade De Kuip nous a offert 5 buts hier soir pour cette demi-finale aller de la Conference League, et l’OM concède sa première défaite depuis son entrée dans la compétition. Retour sur un match où l’OM n’était pas vraiment dedans.
À voir aussi : Avant-match – Feyenoord/OM : « l’Europe dans la peau »
Début cauchemardesque
L’ambiance des grands matchs est au rendez-vous dans le stade. De quoi mettre la pression à nos Olympiens. Et dès le coup d’envoi, c’est Feyenoord qui donne le ton. Sinisterra, l’attaquant colombien, est virevoltant sur son côté gauche et les défenseurs ont du mal à suivre. On sent des joueurs marseillais avec les jambes tremblotantes, presque tétanisés par l’ampleur de l’évènement, et ça ne leur ressemble pas. Dès la 7ème minute, l’attaquant adverse Dessers reçoit un ballon sur un plateau, mais manque totalement sa reprise. Les Marseillais sont complètement acculés vers leur cage, et peinent à tenir la balle. La tactique de Sampaoli est claire : jouer en contre-attaque avec les deux flèches d’attaque que sont Bakambu et Bamba Dieng. Et l’attaquant sénégalais n’est pas loin de donner raison à son coach à la 8ème et et à la 13ème minute de jeu, sur 2 actions presque identiques. Dimitri Payet lance le numéro 12 marseillais en profondeur, mais ce dernier manque de sang-froid dans le dernier geste, et échoue à 2 reprises. On connaît les problèmes de finition de Bamba Dieng, mais chaque supporter marseillais devant son écran se dit : « S’il te plaît, pas maintenant ».
Et l’OM se fait punir de son manque d’acuité devant les cages à la 18ème minute par Dessers, qui se bat bien pour pousser le ballon au fond. L’attaquant nigérian a posé beaucoup de soucis aux Olympiens hier soir, et a su profiter de la fébrilité des défenseurs. 2 minutes plus tard, tout s’écroule. Reiss Nelson, l’ancien d’Arsenal, envoie une passe en retrait à Sinisterra qui permet, avec un peu de réussite, de porter le score à 2-0. Et au moment où l’on voit le rêve d’une deuxième coupe d’Europe s’éloigner, Bamba Dieng, pas trop touché dans sa confiance de ses deux loupés précédents, inscrit un superbe but à l’entrée de la surface à la 28ème minute, et réduit le score.
Feyenoord commence alors à reculer, et les coéquipiers de Steve Mandanda sont récompensés de leurs bonnes intentions à la 40ème minute grâce au but de Gerson, qui récupère un centre mal repoussé par la défense de l’équipe à domicile. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité, et la confiance semble avoir changé de côté.
Des cadres décevants
Guendouzi, Saliba, Caleta-Car, n’étaient pas dans leur meilleure forme dans ce match à enjeu. Et dès le début de la seconde période, le défenseur croate offre un nouveau cadeau à Dessers, avec une passe en retrait pas assez appuyée. Le buteur de Feyenoord, qui arrive lancé, emmène le ballon pour dribbler Mandanda, et n’a plus qu’à le pousser au fond. Ça fait 3-2 pour les adversaires de l’OM, et le score en restera là jusqu’au bout de la rencontre. Les Bleus et Blancs pourront avoir des regrets de cette défaite, car l’opposant semblait largement prenable. Leur attaque très rapide a déboussolé la défense olympienne en début de match, et les buts ont été offerts trop facilement. Dimitri Payet a sûrement été le meilleur Marseillais pour ce choc, mais les autres cadres doivent se mettre au niveau pour le match retour. On n’avait pas encore vu un Guendouzi aussi discret et un Saliba aussi fébrile. Ça ne devrait pas arriver 2 fois.
Dans l’autre demi-finale, les potentiels futurs adversaires de l’OM Leicester et l’AS Rome se sont séparés sur un match nul 1-1. Difficile pour l’instant de deviner les deux clubs qui s’affronteront en finale, car aucune équipe n’a vraiment pris un avantage considérable lors du match aller. Le 5 mai prochain à 21h, le Vélodrome devra être celui des grands soirs, pour permettre aux deuxièmes du championnat de Ligue 1 de s’offrir la 6ème finale de coupe d’Europe de leur histoire.
J.M
Calendrier – Le salon Euroméditerranée à Marseille, rendez-vous des industriels de la mer
Pour sa 5ème édition, le salon euroméditerranéen de la croissance bleue ouvrira ses portes du mardi 28 au jeudi 30 juin, au Parc Chanot à Marseille. Organisé par le quotidien régional Ouest-France et son pôle d’informations maritimes Infomer, ainsi que par la filiale Sogena qui a pour but de promouvoir les activités navales et maritimes, Euromaritime est le rendez-vous bisannuel des entreprises maritimes.
Avec 260 exposants, 1 975 auditeurs et 5 000 visites de 40 pays en 2020, le salon propose cette année plusieurs espaces d’expositions et de rencontres : le Palais de la Méditerranée sera dédié à l’espace SEAnnovation, avec 15 start-ups proposant des innovations maritimes ; l’espace SEAgital mettra en avant l’association France Cyber Maritime qui proposera des solutions en matière de cybersécurité maritime, thème principal du salon de cette année, et SEA-Research proposera au public de voir les dernières découvertes scientifiques maritimes. Enfin, SEA-Protect sera dédié à la promotion des dernières technologies pour la protection des littoraux et des mers. Des conférences seront également proposées pendant ces trois journées autour des avancées et des enjeux maritimes et les risques, tels que la décarbonation.
A l’affiche – « La Ruse », l’histoire de la feinte qui a berné Hitler

Ceux qui ont déjà vu « L’homme qui n’a jamais existé » (sorti en 1956, et qui commence à dater) reconnaîtront sans peine les arcanes d’une affaire peu banale des services secrets britanniques. Mais en temps de guerre, les mystifications se multiplient : certaines tombent à l’eau, d’autres atteignent leur but. D’un côté comme de l’autre, rien n’est laissé au hasard : tout ce qui pourra amener à prévoir les mouvements de troupes de l’ennemi est bon à prendre. A l’image d’un bon roman d’espionnage, façon James Bond ? Cela tombe bien, notre ami Ian Fleming, créateur de l’agent 007, fit véritablement partie de cette aventure.
> A voir aussi : A l’affiche – « Notre-Dame brûle », la cathédrale miraculeusement sauvée
1943. Alors que le flou s’installe sur la situation géopolitique et stratégique des forces en présence (le tournant de la guerre s’inversera au profit des Alliés), le gouvernement britannique envisage un débarquement sur les côtes siciliennes, porte d’entrée à la libération de l’Europe par le Sud. La difficulté consiste à éviter un massacre, en faisant croire à l’exécutif allemand que les Alliés s’apprêtent plutôt à arriver par la Grèce.
le diable se niche dans les détails…
L’une des équipes des services secrets anglais, dirigée par deux brillants officiers, Ewen Montagu (Colin Firth) et Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) est chargée de monter une « affaire cheval de Troie », baptisée en l’occurrence « Operation Mincemeat ». N’essayez pas de traduire ! En français, cela nous donne « Opération chair à pâté » : le charme anglais en moins…
Donner corps à un cadavre
L’idée est « simple », mais comme dans tout bon film d’espionnage – qui, oui, est tiré d’une histoire vraie – le diable se niche dans les détails. D’abord : trouver un cadavre. Puis : lui fabriquer de toutes pièces une identité crédible jusque dans une histoire d’amour, un compte en banque et des places de théâtre. Enfin, larguer le corps de ce pseudo-diplomate muni d’informations corroborant un débarquement en Grèce au large des côtes espagnoles. Les limiers allemands devraient s’occuper de faire remonter l’information, échelon par échelon, jusqu’à Hitler. Pas de droit à l’erreur donc, mais aussi, une bonne dose de chance ! Du « major Martin » dépend une part de la destinée des forces alliées.
un moment plaisant
Qu’ils en soient conscients ou non, les instigateurs de cette machinerie qui peut sembler naïve (mais à laquelle le lion Churchill, qui n’a rien à perdre, a donné son feu vert) mettent chacun un peu de leur vie personnelle dans cette création : la guerre est bien faite par des hommes… Cette histoire vraie retrace l’un des volets les plus invraisemblables de la désinformation en temps de Seconde Guerre mondiale.

Un film bien anglais
« La Ruse » n’est pas à proprement parler un film « haletant » – on déplore quelques longueurs -, mais reste dans une finesse bien différente d’une production américaine à sensation, et fait passer un moment plaisant.
> A voir aussi : A l’affiche – « Le Temps des secrets », un troisième volet simple et fidèle à Pagnol
Colin Firth et Matthew Macfadyen (les plus fidèles des bonnes productions anglaises remarqueront avec amusement qu’ils ont tous les deux joué M. Darcy dans « Orgueil et préjugés ») ainsi que Kelly Macdonald et Penelope Wilton, endossent bien leur rôle. On retrouve un Colin Firth à l’aise dans sa personnalité d’officier sérieux, méthodique, et un brin mélancolique.
Jeanne RIVIERE
L’avis du Méridional : 3,5/5
« A vrai dire », la chronique éco de Pierre Dussol – Démocratie (économique)
Les lecteurs sont suffisamment familiers de la démocratie politique et capables d’en apprécier les agréments pour qu’il soit tentant de faire un parallèle avec la démocratie « économique ».
Dans les deux cas, il y a des « votants » et le même « suffrage universel ». Il est plus universel encore en économie car il n’y pas de condition d’âge. Les consommateurs – c’est-à-dire potentiellement tout le monde – achètent les « produits » qui leur conviennent parmi ceux proposés par « les offreurs ». Ceux-ci, en économie sont les industriels, prestataires de services et commerçants qui vivent plus ou moins bien selon que leurs produits sont plus ou moins appréciés.
> A voir aussi : « A vrai dire », la chronique éco de Pierre Dussol – Inversions
Ils peuvent même vivre très bien, sans même avoir besoin d’une majorité des « votants-consommateurs ». Ceux-ci s’engagent bien plus que par un simple bulletin de vote, puisqu’ils acceptent de dépenser leur propre argent. En compensation, s’ils sont mécontents, ils peuvent modifier leur choix instantanément. Tout le monde peut changer de restaurant plus vite que de député ou de maire…
l’offre économique est beaucoup plus concurrentielle que l’offre politique
Si le consommateur préfère épargner qu’acheter tout de suite, il peut attendre de trouver mieux. L’abstention en politique est possible mais ne permet pas de choisir le meilleur moment pour voter…
Il existe dans les deux cas une concurrence des vendeurs pour vanter et faire acheter leurs produits et services. Les « entrepreneurs politiques » vendent évidemment leurs services sous forme de « promesses électorales ». Elles sont crédibles ou douteuses en fonction de la compétence supposée des candidats et s’ils sont « sortants » jugées sur un bilan de mandat que les électeurs-consommateurs ont subi. Malheureusement il faut attendre la fin du mandat pour changer ou si l’on préfère, un élu ou une assemblée élue n’a pas de compte à rendre pendant toute la durée du mandat.
> A voir aussi : « A vrai dire », la chronique éco de Pierre Dussol – « Défavorisés »
Autre différence, le « vote » en économie est permanent : toute position économique peut être contestée à tout moment et non seulement à l’occasion d’élections, ce qui rend le marché plus sain car les acteurs doivent être beaucoup plus réactifs.
en économie, le vote est permanent
Dans un régime économique de concurrence, tout le monde peut proposer ses produits sous réserve du respect des règles du jeu économique. La publicité mensongère est punie, ce qui fait une différence avec le monde politique évidemment.
L’offre économique est ainsi beaucoup plus concurrentielle que l’offre politique : nul besoin d’être investi par un parti pour créer une entreprise ou ouvrir un commerce.
> A voir aussi : « A vrai dire », la chronique éco de Pierre Dussol – Pouvoir d’achat : produisons !
Finalement la démocratie économique paraît mieux fonctionner : tout le monde peut participer, le système est plus souple, nul besoin d’un président omniscient pour diriger le tout !
Il existe certes des inconvénients comme le risque de manipulation. Est-ce seulement le cas en économie ? Nous reviendrons sur l’information des « clients ».
Pierre DUSSOL
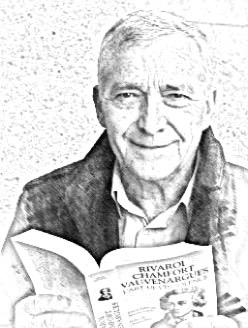
Pierre Dussol est professeur d’économie honoraire à Aix-Marseille-Université. Il a compris depuis belle lurette les méfaits de la torsion des mots sur la désorientation et le vide des esprits. En véritable « redresseur de tors », il a décidé de reprendre les définitions de base qui permettent de mieux décrypter les habillages et autres artifices du politiquement correct. Il livre son point de vue savoureux dans les colonnes du Méridional.
OM – Mandanda, le 100 marseillais
Steve Mandanda jouera ce soir – s’il est titulaire – son 100ème match en coupe d’Europe sous les couleurs olympiennes, ce qui en fait le joueur le plus capé de l’histoire en compétition européenne avec un club français. Il devrait démarrer cette demi-finale aller de la Conference League face au Feyenoord titulaire et capitaine. Un contexte idéal pour passer la barre symbolique des 100 rencontres disputées sur le continent, et mérité pour l’exemplaire portier de l’OM.
La belle histoire d’amour entre Mandanda et l’Europe avait commencé au Stade Vélodrome le 18 septembre 2007 face au Besiktas, en phase de poule de la Ligue des Champions. Il devra ce soir mettre toute son expérience au service de ses coéquipiers si les Marseillais veulent l’emporter.
Un record de plus pour le gardien le plus capé de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Légendaire.
Ne manquez pas cette affiche en suivant le live commenté du Méridional sur nos chaînes Youtube, Facebook et Twitch dès 20h45.
Industrie du territoire – Création de l’UIMM Région Sud/Corse : un changement pour le secteur de la métallurgie
En Région Sud, la métallurgie se présente comme un secteur clef de l’économie, puisqu’elle engage environ 850 entreprises et plus de 50 000 salariés. Pour mieux représenter et promouvoir les intérêts de ces entreprises, l’Union des industries et des métiers de métallurgie (UIMM) continue à accompagner les mutations sociales en avril, avec des changements considérables, voire considérés comme « historiques ».
Une nouvelle convention pour garantir une plus grande sécurité juridique
Jeudi 7 avril, après 6 années de négociations, l’UIMM, qui regroupe les principales entreprises françaises de métallurgie, s’alliait avec trois autres syndicats dont la Force Ouvrière (FO), la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) pour la création d’une nouvelle convention collective pour les salariés de métallurgie, qui entrera en vigueur dès 2024.
Convention considérée comme « historique »vis-à-vis des conditions de travail des métiers de la métallurgie, elle s’étend sur trois points : d’abord, elle instaure davantage d’équité des emplois, qui seront classés selon six critères principaux, comme la validation des connaissances, la contribution et la coopération, la communication, la description des tâches et l’autonomie. Ensuite, la convention contraint le salaire minimal à être établit au niveau national, puis améliore la couverture sociale avec la mise en place d’un système de prévoyance pour les freins au travail, comme l’incapacité ou l’invalidité.
Création de l’UIMM Régions Sud Corse, un nouvel élan pour les métiers de la métallurgie
A la suite de la convention du 7 avril, l’UIMM Alpes-Méditerranée, Côte d’Azur et Vaucluse ont uni leurs forces et leurs moyens pour la création de l’UIMM Région Sud Corse ce mercredi 27 avril. Cette nouvelle organisation bi-régionale a pour but de construire une nouvelle industrie de la métallurgie,performante, moderne et attractive, qui s’adapte aux évolutions sociales et économiques de notre société. Complémentaire aux trois UIMM créatrices, elle représentera en leur nom les intérêts des entreprises.
La plateforme juridique inter CST UIMM, un service de proximité pour les salariés
Pour représenter correctement les entreprises et pour assurer le respect de la nouvelle convention, la plateforme juridique inter CST UIMM, destinée aux adhérents des trois chambres syndicales territoriales, propose des consultations entre les entreprises, les salariés et des juristes. Elle permet de répondre à leurs interrogations sur leur rémunération, « l’hygiène, la durée de travail, la sécurité et l’environnement », selon un communiqué de presse de l’UIMM Régions Sud Corse.
Ces mesures permettent de faire évoluer l’industrie de la métallurgie : les salariés et les entreprises sont davantage entourés et écoutés, et les relations sociales sont nettement améliorées.
I.S
Regards sur le monde – Le difficile retour des Yézidis au mont Sinjar
En 2014, l’Etat islamique en Irak et au Levant lance de grandes offensives sur l’Irak et conquiert une large partie du territoire pour y instaurer le califat islamique. Lors de cette guerre, les Yézidis, une communauté ethno-religieuse d’Irak, ont été les victimes d’un génocide. Aujourd’hui, bon nombre vivent encore dans les camps. Leur avenir est plus qu’incertain.
Presque cinq ans après la guerre, la nature reprend ses droits sur les paysages désolés de la plaine de Ninive. « Vous savez, nous avons beaucoup reconstruit depuis la libération », nous lance le chauffeur de taxi. Sa voix perce à peine le bourdonnement de son vieux véhicule : « L’armée irakienne et les milices se sont battues sur ce tronçon jusqu’à la ville de Qaraqosh. » Lui-même est un Peshmerga, un combattant kurde, comme en témoigne sa carte de combattant, coincée dans le pare-soleil de son taxi, tandis qu’un chapelet chrétien perle le long du levier de vitesse. Le contraste peut sembler saisissant mais il n’est pas rare que des chrétiens soient aussi des soldats kurdes, « pour arrondir les fins de mois ».
le massacre du mont sinjar a rendu plus de 2 700 enfants yézidis orphelins
Le 3 août 2014, les Yézidis sont victimes d’un massacre perpétré par l’Etat islamique d’Irak et du Levant, plus connu sous son acronyme : Daech. Ce même jour, près de 6 500 personnes sont capturées et des milliers sont exécutées. Parmi les prisonniers de Daech se trouvent des femmes et des enfants. Les jeunes filles et petites filles à partir de 9 ans sont réduites en esclaves sexuelles entre la Syrie et l’Irak tandis que les garçons sont envoyés dans les camps d’entraînement de Daech.
Le massacre du mont Sinjar a rendu plus de 2 700 enfants yézidis orphelins et a fait plus de 30 000 déplacés. Amnesty International estime à 3 000 le nombre de Yézidis disparus. Les Nations Unies n’ont pas hésité à qualifier ce massacre de génocide relevant du crime contre l’humanité et du crime de guerre.
La vie impossible dans les camps
La plaine, que l’on traverse à grande vitesse, porte encore les stigmates du conflit : trous d’obus profonds et recouverts de végétation, maisons détruites, noires d’une suie ancienne, postes d’observation fortifiés par de lourds sacs de sable tenus par les Peshmergas et camps de déplacés internes. Le velours vert de la plaine fait ressortir l’éclatante blancheur de la multitude de tentes, entourées de barbelés et de postes de garde. Au bout de la route se trouve un check-point massif. Il marque le passage du Kurdistan irakien vers l’Irak.

De l’autre côté du check-point, Louis nous attend. La carrure imposante, les cheveux blancs et une épaisse moustache, il travaille pour l’ONG irakienne Hammurabi Human Rights Organization (HHRO) à Erbil et Mossoul. HHRO est une ONG irakienne créée en 2005 par Pascale Warda, ancienne ministre de l’Immigration et des Réfugiés, et son mari, William Warda. Cette ONG a pour but de promouvoir et de protéger les droits de l’homme en Irak à l’échelle régionale, nationale et internationale. Elle s’occupe particulièrement des minorités du pays : chrétiens, yézidis, sabéens, mandéens, Turkmènes, assyriens, Arméniens, etc. Louis enquête et se documente sur les crimes de Daech pendant la période de la guerre notamment auprès des victimes de la minorité yézidie.
dans les camps, le taux de suicide est élevé
Il existe encore 16 camps qui accueillent des réfugiés. Le quotidien y est rude. L’hiver est glacial sous les frêles tentes. Les incendies sont fréquents dans les camps à cause d’installations électriques vétustes. Le taux de suicides est élevé en raison de la misère, pauvreté et de la perte d’espoir. « Ce sont surtout les femmes qui se donnent la mort, souligne Louis. Il y a plusieurs facteurs : l’éloignement du foyer, la pauvreté et les conditions de vie difficiles dans les camps. Nous essayons de les aider à rentrer chez eux en payant les transports ou à créer une petite entreprise. La plupart des familles n’a plus de maison dans leur village d’origine. » Le retour de la communauté yézidie au mont Sinjar est complexe. Plusieurs milices et armées régulières s’y affrontent toujours pour le contrôle de ce point stratégique.
Marie-Charlotte NOULENS
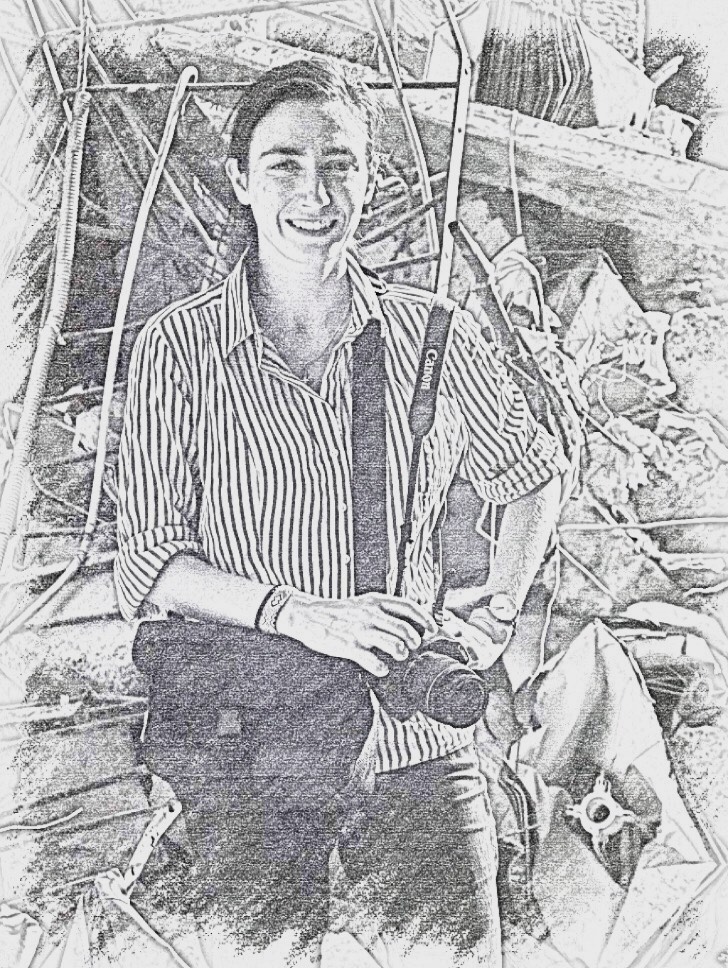
Marie-Charlotte Noulens est journaliste depuis cinq ans. Elle est passée par la presse locale en Normandie avant de travailler à Bangkok pour « Asie Reportages ». Elle a rejoint ensuite le magazine « Aider les autres à Vivre », pour lequel elle écrit sur des sujets de société, principalement dans des zones touchées par la guerre ou encore, autour de la précarité en Afrique, au Moyen Orient et en Asie du Sud-Est. Elle se déplace à l’étranger et livre dans les colonnes du Méridional ses analyses sur l’actualité internationale.