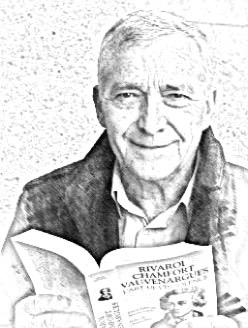Alain Bogé est spécialisé en Géopolitique, Relations Internationales et Commerce International. Il a notamment donné des cours à l’université de Lyon 3, à Lille et en Inde. Il enseigne actuellement à l’université de Prague et à l’European Business School de Paris.

> A voir aussi : Panorama des ambitions russes en Méditerranée (1/3)
L’activité russe en Méditerranée orientale a connu une hausse dans le contexte plus large de son « retour » au Moyen-Orient. Cette activité se rapproche d’un concept de « Realpolitik ». Dans cet environnement redevenu plus accessible à l’influence de la Russie, celle-ci recherche d’autres points d’appui en Méditerranée orientale que la seule Syrie – qui demeure son point d’appui principal. Tour d’horizon des pays méditerranéens auxquels s’intéresse la Russie.
La stratégie d’influence de la Russie dans la région est double : à la fois diplomatique et militaire. Pragmatisme oblige, le Kremlin va soutenir des pays souverains quelle que soit la nature du régime du pays en question, ce qui rassure des pays comme l’Egypte et la Turquie.
La Syrie est le centre du dispositif stratégique de la Russie en Méditerranée orientale. Les relations entre Moscou et Damas ne datent pas d’aujourd’hui. Elles ont débuté en 1956 à l’occasion de la crise de Suez. En 2013, dans le contexte de la guerre civile syrienne, la Russie applique son veto au Conseil de sécurité des Nations unies : elle s’oppose à une opération militaire occidentale après les attaques à l’arme chimique qui ont eu lieu le 21 août ; la communauté internationale accusant Bachar el-Assad d’être responsable, la Syrie et la Russie considérant pour leur part qu’il s’agit des rebelles. Le 30 septembre 2015, le président syrien demande officiellement une aide militaire à la Russie. Moscou intervient donc en Syrie et confirme ainsi son statut d’acteur majeur au Moyen-Orient.
L’opération militaire en Syrie va constituer une évolution dans la politique étrangère russe : contrairement aux conflits ukrainien, géorgien et tchétchène, la Russie est engagée dans un pays avec lequel elle ne partage aucune frontière, ce qui suppose la mise en place d’une logistique très importante en moyens déployés. Le statut base de Tartous est officialisé en 2017 et cette base devient le seul point d’appui russe en Méditerranée, capable d’accueillir onze navires de guerre. Des troupes russes sont présentes sur le terrain et collaborent avec les forces privées du groupe Wagner. Cette base navale est couplée avec la base aérienne de Hmeimim/Lattaquié.
Par ailleurs, la Russie a mis progressivement en place une stratégie de « déni d’accès » (interdiction de zones) au large de la Syrie avec, notamment, une présence navale permanente au large des côtes (à partir de Tartous), notamment via des sous-marins, et un déploiement d’un système de défense côtière Bastion-P doté de missiles de croisière anti-surface (350 km de portée). De plus, la Russie ferme, parfois pour plusieurs jours, des zones maritimes et aériennes au large de la Syrie, sous prétexte d’exercices militaires. La Syrie est ainsi devenue un « laboratoire d’essais » en matière de stratégie militaire marine/terre. Mais surtout, le pays est devenu une sorte de satellite, sur le mode biélorusse, donnant ainsi à Moscou un solide point d’appui en Méditerranée orientale au cœur de la zone de tensions Iran/Israël.
L’Egypte du maréchal el-Sissi constitue un partenaire clef à l’échelle régionale vu de Moscou. Les deux pays ont signé un accord de coopération stratégique en octobre 2018. Les relations économiques se développent dans le domaine énergétique et militaire avec des exercices conjoints dans le domaine aérien (Flèche de l’amitié en 2019) ou maritime (Pont de l’amitié en 2020).
Du côté de la Turquie, les rapports entre les deux pays sont ambigus et parfois violents. Il y a un contentieux historique : la Turquie et la Russie ont toujours entretenu des relations conflictuelles. Quatorze guerres ont opposé la Turquie à l’empire russe avec de rares périodes d’accalmie. Par ailleurs, la mer Noire constitue une zone où les influences des deux pays se télescopent. Ankara refuse toujours de reconnaître l’annexion de la Crimée par la Russie. Le président Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé récemment son soutien à l’Ukraine en livrant, entre autres, des drones « Bayraktar » à l’armée ukrainienne. Dans le Caucase, Ankara a soutenu l’Azerbaïdjan alors que Moscou soutenait (mollement certes) l’Arménie. La Turquie est membre de l’OTAN et abrite sur son territoire la base militaire américaine d’Incirlik, proche de la mer Noire. Mais, en achetant aux Russes le bouclier anti-missiles S-400 entre autres, la Turquie sert la Russie en lui offrant un marché important et en remettant en cause la politique d’armement de l’OTAN. En dépit d’un passé historique assez lourd, les deux pays développent une relation transactionnelle et pragmatique, où la Russie a clairement le rôle prépondérant.
Du fait de la position stratégique du Liban (qui a des frontières avec la Syrie et Israël, ainsi qu’une façade maritime), la Russie est particulièrement attentive à l’évolution de la situation politique du pays. Etant donné la situation déliquescente de l’économie libanaise, il n’y a pas de réels échanges commerciaux avec la Russie qui se tient néanmoins prête à aider le Liban à résoudre ses problèmes avec des arrière-pensées de « soft power ».
Le positionnement d’Israël vis-à-vis de Moscou va dépendre dans les prochains mois, de la perception qu’ont les autorités israéliennes de l’engagement régional de Washington et de sa capacité de soutien. Les relations entre la Russie et Israël sont ambivalentes. D’abord réticente à la constitution d’un nouvel État au Moyen-Orient, l’URSS a opéré un tournant en 1947. Aujourd’hui, les Russes constituent la plus importante communauté juive d’Israël.