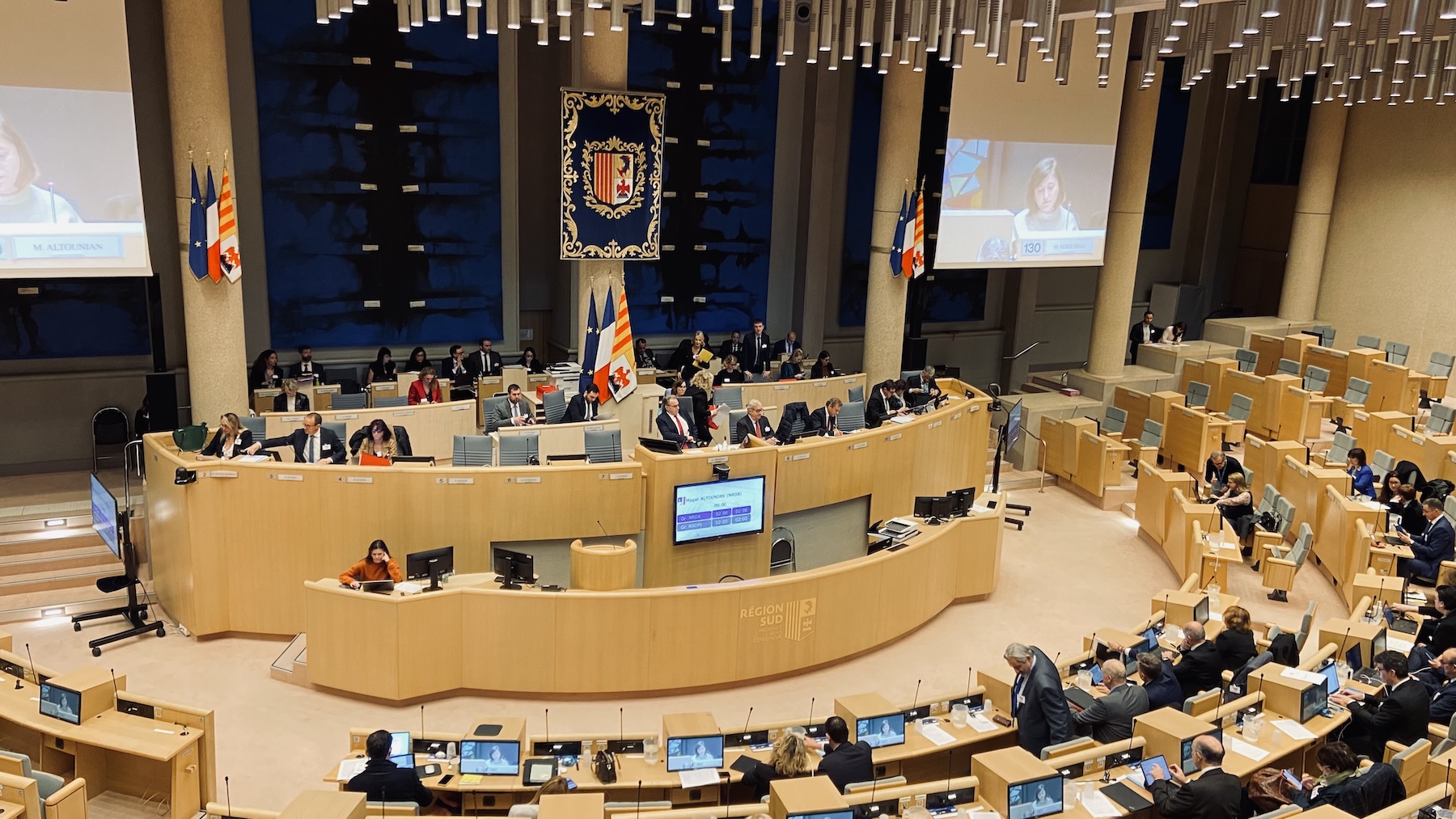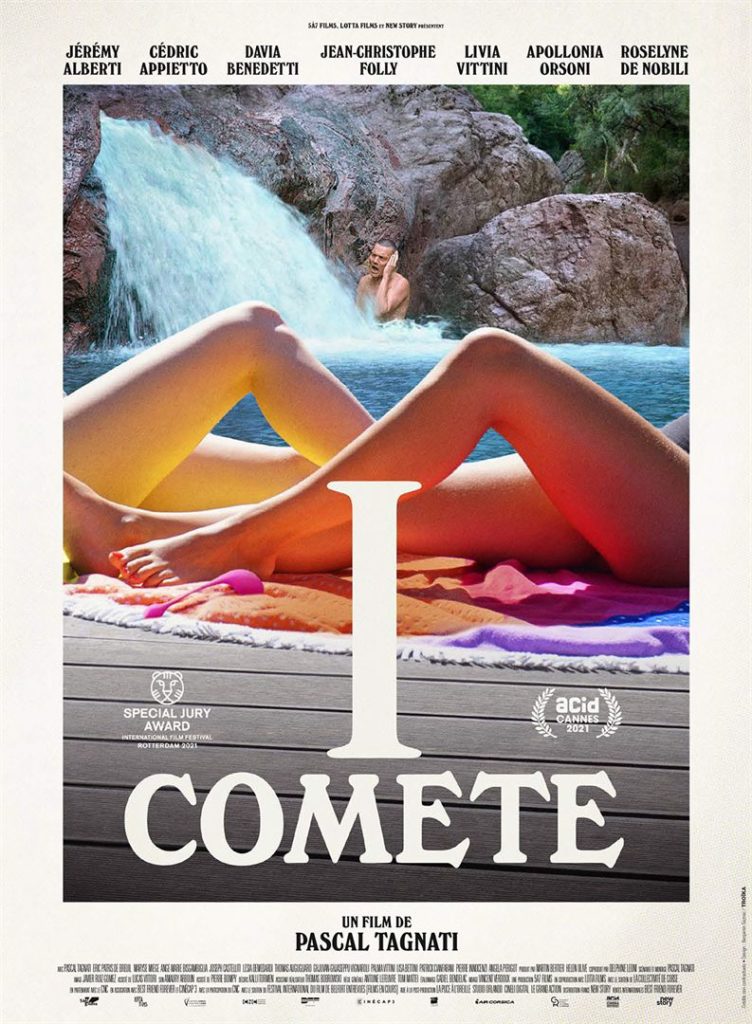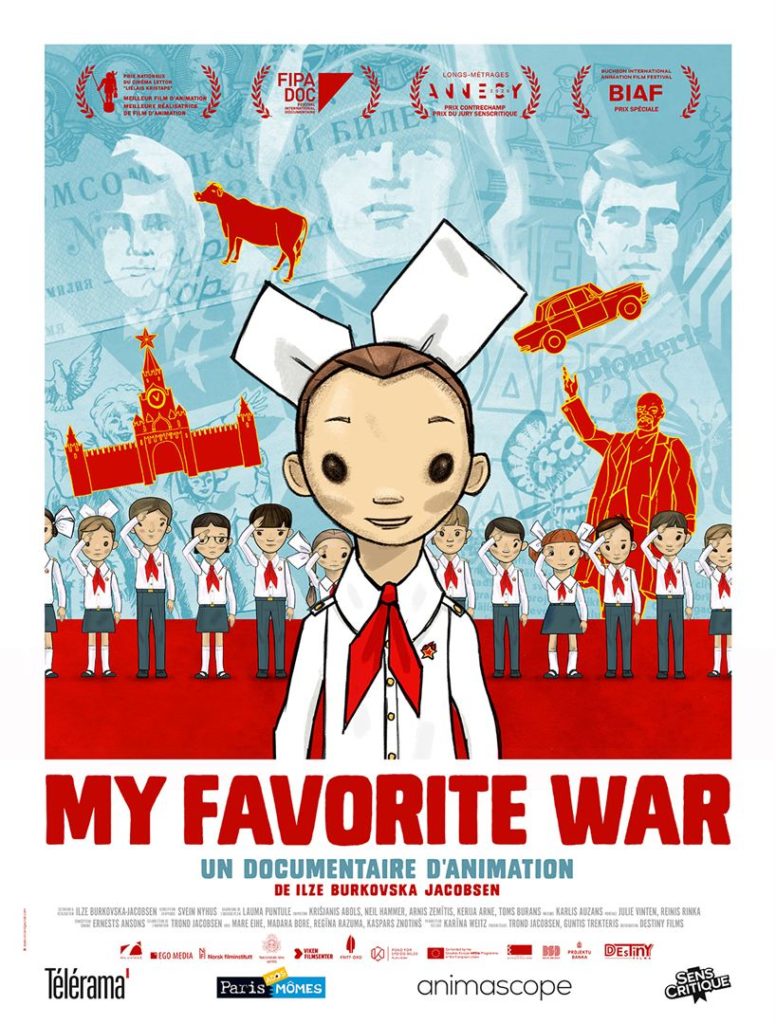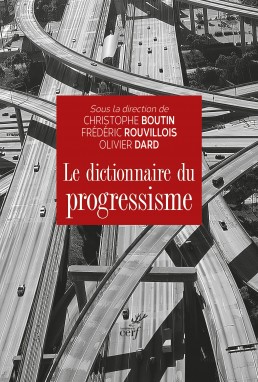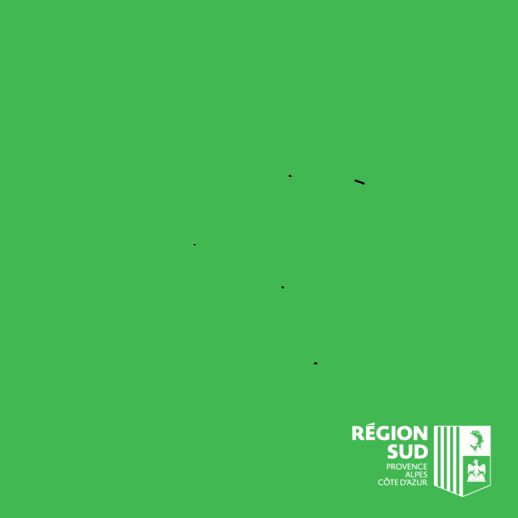Le député LR de la sixième circonscription de Marseille (9ème/10ème), Guy Teissier, élu et réélu à maintes reprises à l’Assemblée nationale par les Marseillais des quartiers sud, ancien maire de secteur, ancien président de la communauté urbaine Marseille-Provence, conseiller municipal de Marseille, principal conseiller et ami d’Eric Ciotti, a bien voulu répondre aux questions du Méridional.
Le Méridional : M. Teissier, vous qui avez une longue expérience de la vie politique, que pensez-vous des résultats relativement faibles de la candidate des Républicains au premier tour des présidentielles ?
Guy Teissier : Ecoutez, je ne vais pas chercher midi à quatorze heures : c’est un naufrage. Mais un naufrage en partie injuste. N’oubliez pas que lorsque Valérie Pécresse a annoncé sa candidature, elle était donnée gagnante au second tour face à Emmanuel Macron. C’est son premier grand meeting au Zénith à Paris qui a été un désastre.
A partir de là, les médias ont sonné l’hallali pour la mort de la bête. Elle surjouait un rôle et n’était pas prête pour endosser les habits d’une présidentiable. En revanche, ses quinze derniers jours de campagne ont été excellents mais il était trop tard pour remonter la pente.
L.M : Est-ce que les électeurs LR ont privilégié, à votre avis, le vote utile et voté d’emblée en faveur d’Emmanuel Macron ?
G.T : Oui. Dans un sens les électeurs des Républicains se sont dit : de toutes façons elle sera battue, ça ne sert à rien de voter pour elle. Je pense que Valérie Pécresse avait un bon programme, mais est-ce que les électeurs en ont vraiment pris connaissance ? Elle a été soumise à la tyrannie des sondages quotidiens qui orientent l’opinion. Vous savez, je me suis rendu compte en cinquante ans de vie politique, que la plupart des gens volent au secours de la victoire.
L.M : Ne faut-il pas interpréter le choix de Mme Pécresse, au lieu du populaire Eric Ciotti, comme une sorte d’auto-sabordage volontaire de la direction des Républicains pour laisser le champ libre à Macron en échange d’un certain nombre de circonscriptions ?
G.T : Non, pas du tout. Il est vrai que M. Macron veut continuer à casser la baraque pour s’installer dans un marais central qui exclut les extrêmes. Mais je pense qu’Eric Ciotti a fait un excellent score à la primaire, je le soutiens encore et toujours.
« valérie pécresse a été soumise à la tyrannie des sondages »
Le parti a sans doute fait le choix d’une femme, non pas en raison de sa représentativité présumée, mais parce que c’est une femme et c’est dans l’air du temps. Je suis persuadé que Ciotti, qui incarne une droite assurée et assumée, aurait mieux correspondu aux attentes du peuple de droite.
De toutes façons, j’étais opposé à ce congrès qui était en réalité une primaire qui ne disait pas son nom. Lors de ce genre d’élections internes, on ne représente qu’une infime minorité des Français. La seule primaire que je reconnaisse, c’est une primaire ouverte à tous les Français, encartés ou pas. C’est un choix populaire qui avait permis à François Fillon d’être notre candidat.
L.M : Que pensez-vous des personnalités naguère sarkozystes comme Eric Woerth, Christian Estrosi, Hubert Falco, Renaud Muselier, Martine Vassal qui ont choisi de déserter leur parti et de faire allégeance à Emmanuel Macron ?
Pour moi, ces trahisons sont écœurantes parce qu’il s’agit de personnes estimables qui ont réussi de belles carrières politiques. Elles ont prospéré sous l’étiquette RPR ou UDF, puis à l’UMP et aux LR et leur changement de bord relève de l’opportunisme. Qu’on puisse tourner ainsi sa veste après tant d’années de fidélité à ses convictions m’attriste et me dégoûte.
Un parti politique, voyez-vous, c’est d’abord une grande famille. Or, la volonté du président de la République de créer un grand gloubi-boulga central et protéiforme est inquiétante pour la démocratie. Car ce bloc est tiraillé en permanence sur sa gauche et sur sa droite.
Le président est déjà revenu sur sa réforme des retraites et s’apprête à l’assouplir. Il faut qu’il satisfasse un magma hétéroclite composé de PS, PC, écolos, libéraux, centristes et opportunistes. Or, des manifestations orchestrées par la CGT se profilent déjà à l’horizon. Et cette élection a montré que l’extrême gauche était un vrai danger pour la France.
Tous ces braves gens se coalisent pour « faire barrage » à Marine Le Pen et nous avons droit comme en 2017 au « petit théâtre de l’antifascisme », comme le reconnaissait Lionel Jospin en 2007.
L.M : A Marseille, au sein du conseil municipal, comment d’anciens leaders des Républicains pourront-ils fraterniser avec des socialistes comme Benoit Payan qui ont rejoint eux aussi le président ?
Il est vrai que certains de mes collègues ont fait un choix assez curieux. Mais je vous assure que l’opposition municipale est restée une opposition résolue à l’extrême gauche et au Printemps marseillais. Nous ne pactisons avec personne.
« les ralliés à macron ne sont pas pour autant des ralliés à payan »
Les ralliés de la vingt-cinquième heure à Macron ne sont pas pour autant des ralliés à Payan. Ce que je constate, c’est que l’appel du président pour faire cesser les chicayas de cour d’école entre élus à Marseille a été entendu, ce qui a permis aux collectivités de bénéficier de la manne de l’Etat.
M. Guérini n’avait donné que vingt millions d’euros à la ville de Marseille alors que Mme Vassal en a déjà alloué 200 millions ! On ne peut plus adhérer aux stratégies du pain sec et de l’eau initiées par MM. Defferre ou Vauzelle, il faut que les projets en matière de restauration des logements, des écoles et des transports puissent se réaliser dans l’intérêt majeur du public.
L.M : Près de soixante quinze pour cent des électeurs qui se sont prononcés au premier tour rejettent massivement Emmanuel Macron et il risque d’être élu de nouveau pour cinq ans. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
G.T : C’est simple : au premier tour on choisit, au second tour on élimine.
L.M : Comment jugez-vous l’ascension fulgurante d’Eric Zemmour dans les sondages à l’automne et sa chute lors des dernières semaines de la campagne ?
G.T : Zemmour a démarré sa campagne en trombe en réalisant une percée conceptuelle remarquable. Par sa franchise et sa manière de dire le réel, il a bougé le cursus des thèmes habituels abordés par les politiques. Avec les sujets sur l’immigration, l’identité, l’islamisme, tout le monde en a pris pour son grade. Il a clairement montré qu’une immigration de masse et ses répercussions démographiques pouvaient à terme porter un coup fatal à l’identité française.
Lui, son leitmotiv c’est que la France reste la France. Mais il a commis plusieurs erreurs. Son côté polémiste l’a desservi car on ne parle pas aux Français comme on parle sur un plateau de télévision.
Il n’avait pas besoin de se prononcer contre l’accueil en France des réfugiés de guerre de l’Ukraine. Ce sont des femmes, des enfants, des personnes âgées qui fuient les théâtres d’opérations et doivent être accueillis chez nous. Prétendre qu’ils n’ont qu’à aller en Pologne, c’est inadmissible et Zemmour l’a payé très cher dans les urnes. D’ailleurs, la quasi-totalité de ces réfugiés ukrainiens n’aspirent qu’à rentrer chez eux une fois la guerre terminée.
L.M : Peut-on considérer que les scores étriqués de M. Jadot, de Mme Hidalgo et de M. Zemmour sont liés eux aussi au vote utile en faveur de M. Mélenchon ou de Mme Le Pen ?
G.T : Oui, c’est vrai. La candidature de Mme Hidalgo n’a jamais été vraiment admise par son propre camp et M. Jadot était très contesté lui aussi dans son propre camp, d’où la tentation des socialistes et des écologistes de prêter main forte à Mélenchon qui a eu l’habileté de modeler son discours pour les attirer à lui. Mélenchon est un tribun mais les gens oublient souvent qu’il soutient des régimes marxistes comme celui de Cuba ou du Venezuela de Chavez qui ont commis des crimes contre l’humanité.
« on ne parle pas aux français comme on parle sur un plateau de télévision »
L.M : A votre avis, la peur de Marine Le Pen, bien orchestrée par les médias, sera-t-elle plus forte que la détestation de Macron le 24 avril ?
G.T : Je ne suis pas Madame Soleil et je ne lis pas dans la boule de cristal. J’ignore quelle détestation sera la plus importante. Je pense qu’une grande partie de l’électorat de M. Mélenchon va être tentée par l’abstention, mais une autre partie est constituée de bobos qui souhaiteront retourner à leurs radis et à leurs éoliennes. Ils iront voter en se pinçant le nez pour le président sortant parce que ces gens jouent à se faire peur, mais sans jamais aller jusqu’au bout de leur engagement.
L.M : La droitisation de la France n’a jamais été aussi forte. Comment la France peut-elle être de nouveau gouvernée par un homme de gauche ?
G.T : Le sentiment qui habite le peuple français, c’est la désespérance. Ce pays est marqué par une pauvreté discrète et un discrédit majeur de la classe politique. Les Français ne croient plus en rien. Ils sont dans la souffrance et ils ont besoin d’espoir. Ceux qui proposent d’allumer une lumière au bout du tunnel comme Mélenchon ou Le Pen font de gros scores, même si ce sont des illusionnistes. Si M. Macron continue sa politique de destruction au cours de son second mandat, la France sera dans un état pitoyable dans cinq ans.
L.M : A Marseille, dans votre circonscription, Mme Le Pen a obtenu 14 253 voix et terminé en tête devant M. Macron avec 13 911 voix et M. Mélenchon avec 12 740 voix. Si l’on ajoute au score de Mme Le Pen les 7684 voix obtenues par Eric Zemmour, comment votre poulain Didier Réault a-t-il la moindre chance de vous succéder à l’Assemblée nationale en juin ?
G.T : En politique, les calculs d’apothicaire sont déconseillés car l’élection législative n’a rien à voir avec une élection présidentielle : ce sont deux élections complètement différentes. Croyez-moi, ce qui compte avant tout aux législatives, c’est l’ancrage local du candidat. Tel est le cas de Didier Réault que je soutiendrai. Je note qu’il n’y aura aucun accord entre Mme Le Pen et M. Zemmour pour les législatives et qu’aucun des deux ne franchira la barre des 12,5 pour cent des inscrits pour figurer au second tour. Je ne pense pas non plus que, comme la dernière fois, il suffira à des inconnus d’exhiber la tête de M. Macron sur leurs affiches pour être élus. Aux législatives, vous pourrez vous rendre compte que les Républicains ne sont pas moribonds mais au contraire bien vivants. Car les Français ne voudront pas donner tous les pouvoirs au même homme ou à la même tendance.
Propos recueillis par José D’ARRIGO, rédacteur en chef du Méridional