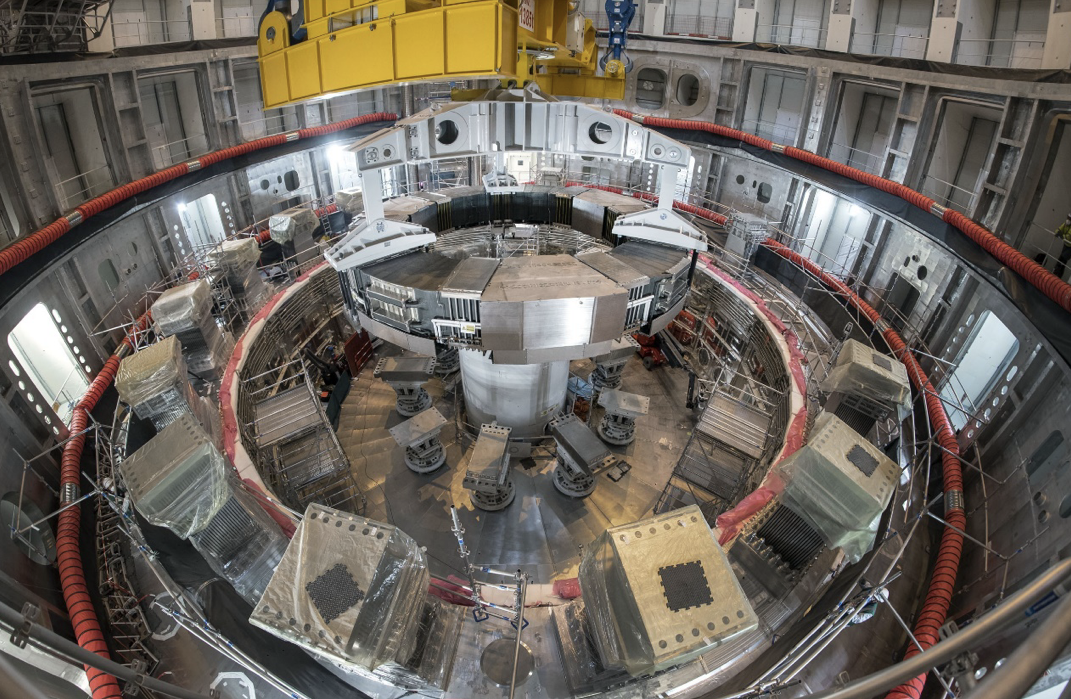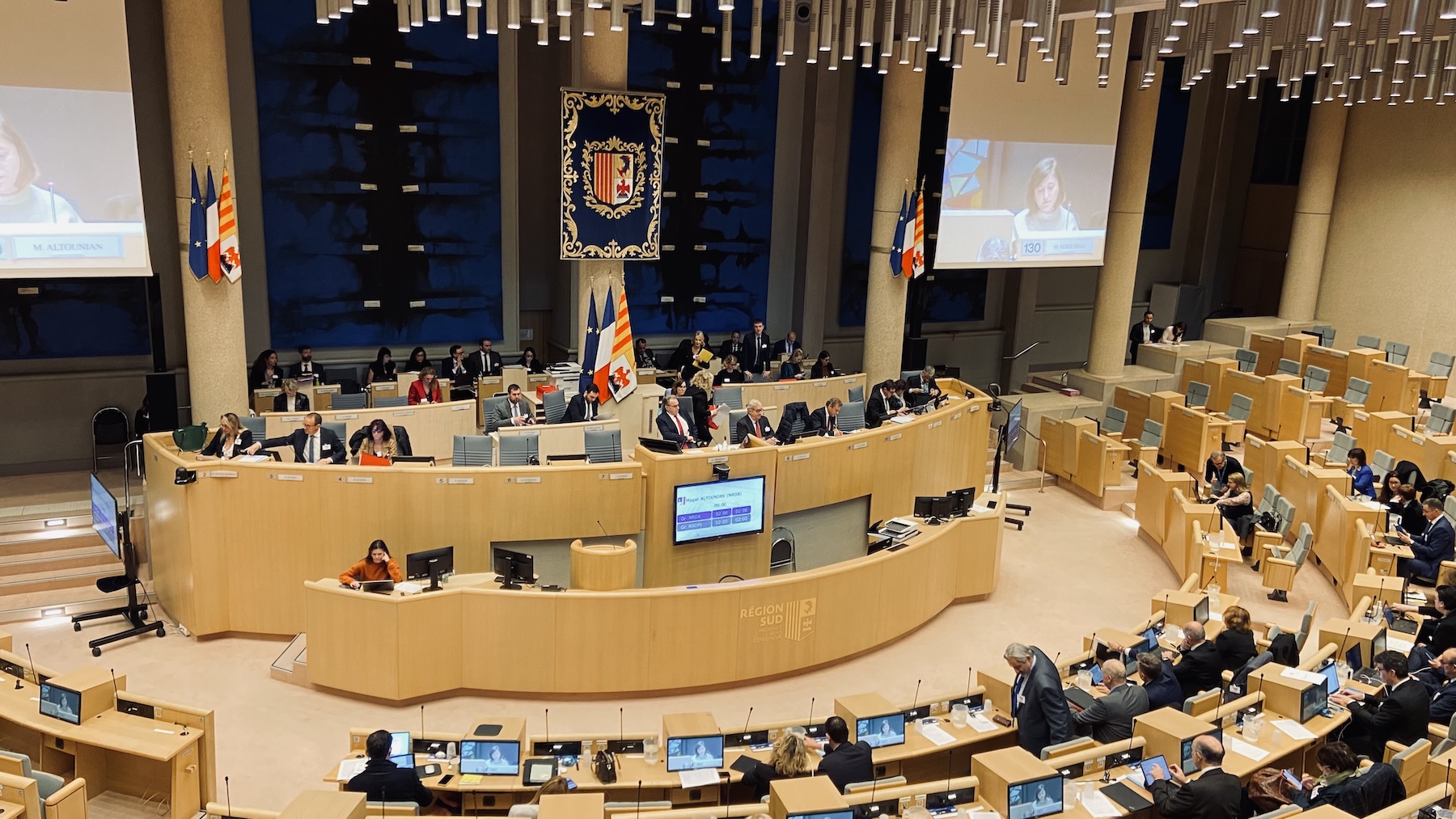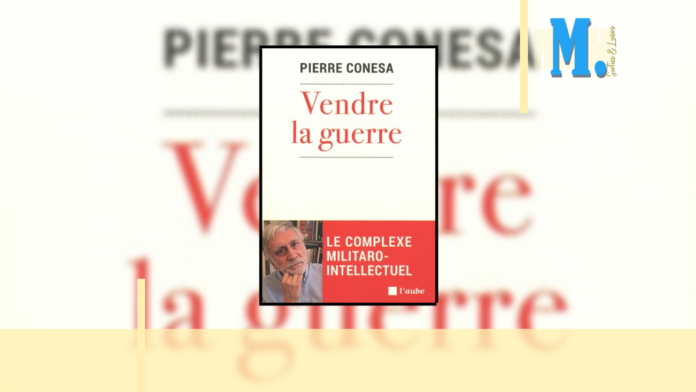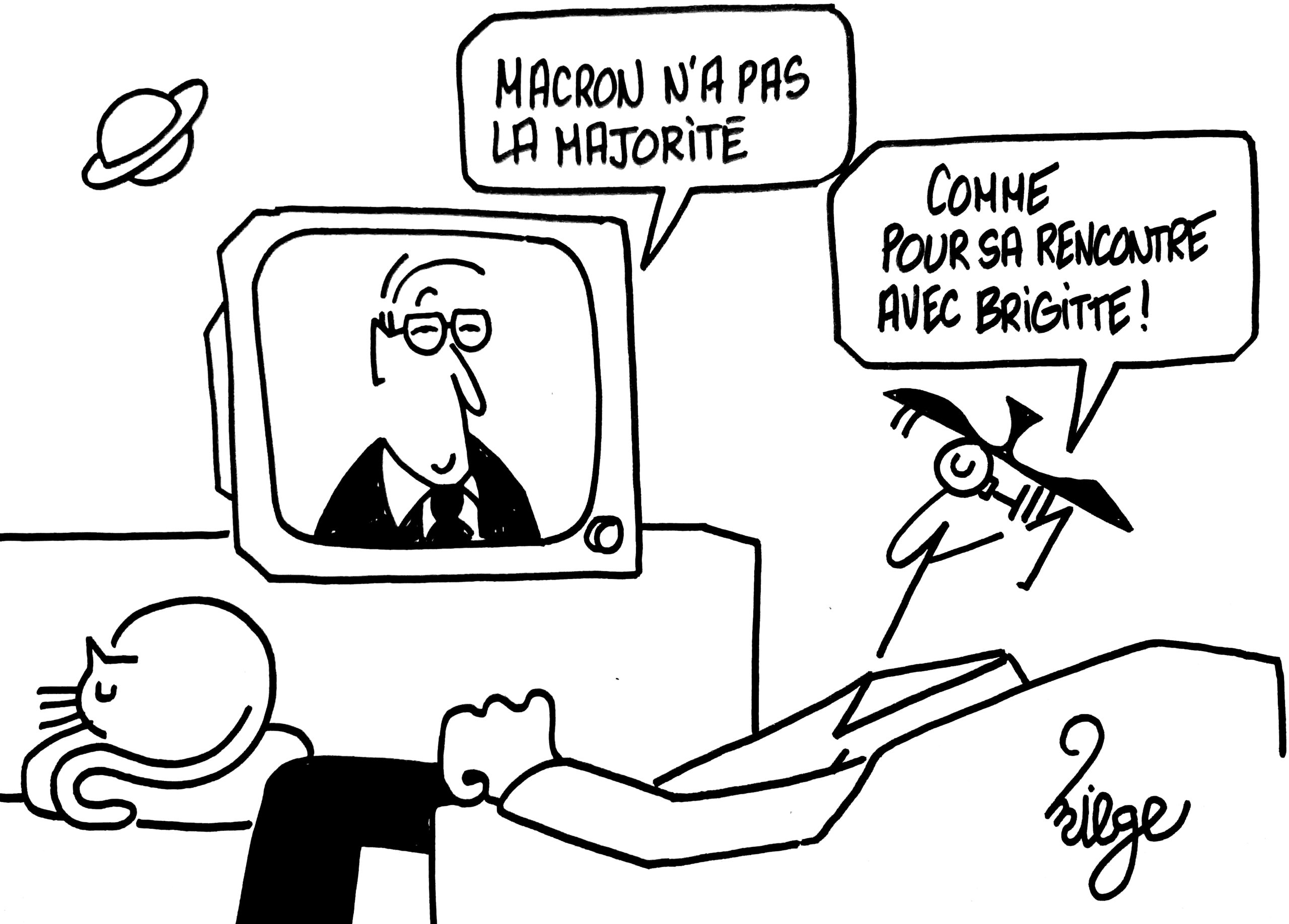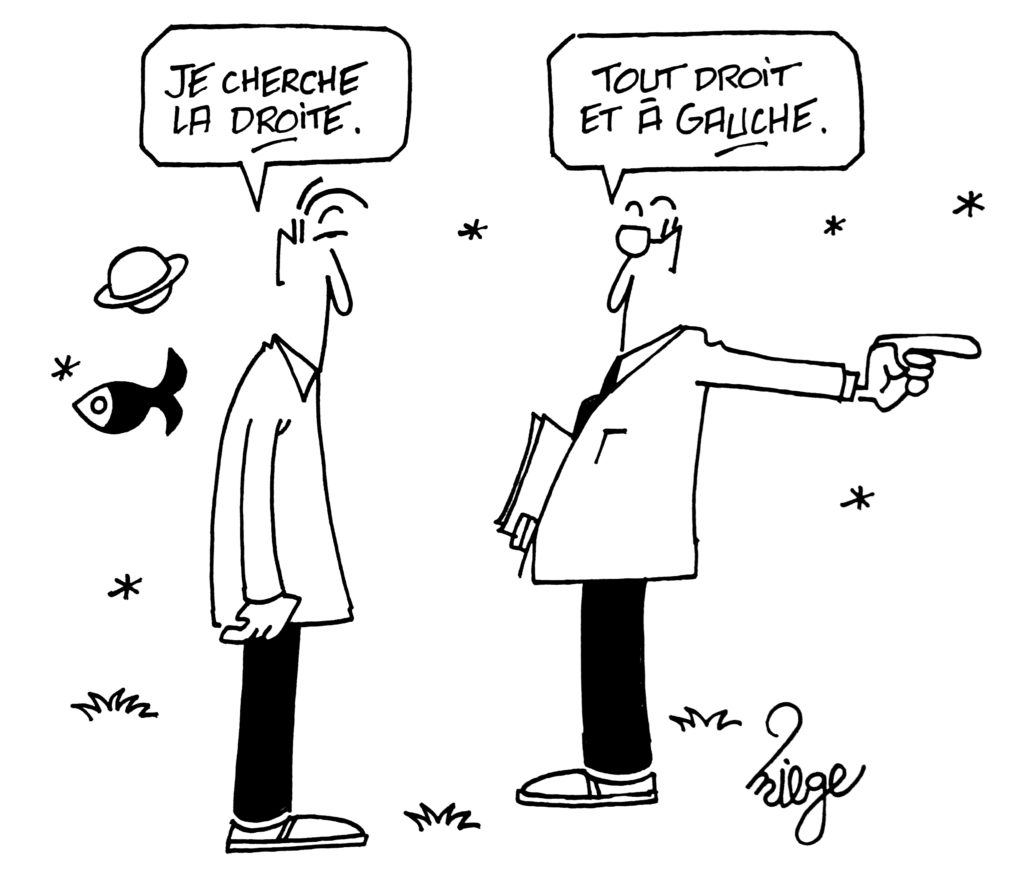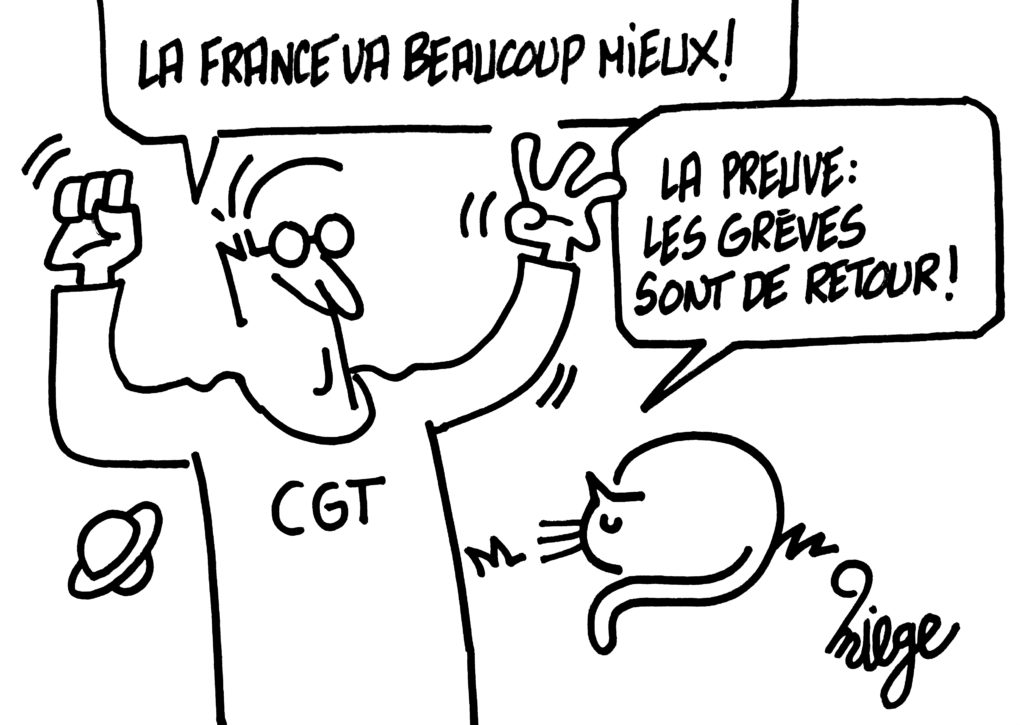La liste officielle du gouvernement « Borne 2 », dévoilée ce lundi matin par l’Elysée :
Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique
Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer
Catherine COLONNA, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Eric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Sébastien LECORNU, ministre des Armées
Olivier DUSSOPT, ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion
Pap NDIAYE, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse
Sylvie RETAILLEAU, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Marc FESNEAU, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Christophe BECHU, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition énergétique
Rima ABDUL-MALAK, ministre de la Culture
François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention
Jean-Christophe COMBE, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées
Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques
Amélie OUDEA-CASTERA, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Les ministres délégués
- Auprès de la Première ministre :
Olivier VERAN, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement
Franck RIESTER, chargé des Relations avec le Parlement
Isabelle ROME, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances
- Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique :
Gabriel ATTAL, chargé des Comptes publics
Roland LESCURE, chargé de l’Industrie
Jean-Noël BARROT, chargé de la Transition numérique et des Télécommunications
Olivia GREGOIRE, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme
- Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :
Caroline CAYEUX, chargée des Collectivités territoriales
- Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer :
Jean-François CARENCO, chargé des Outre-mer
- Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :
Olivier BECHT, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger
- Auprès du ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion et du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse :
Carole GRANDJEAN, chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels
- Auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :
Clément BEAUNE, chargé des Transports
Olivier KLEIN, chargé de la Ville et du Logement
- Auprès du ministre de la Santé et de la Prévention :
Agnès FIRMIN LE BODO, chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé
- Auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées :
Geneviève DARRIEUSSECQ, chargée des Personnes handicapées.
Les secrétaires d’Etat
- Auprès de la Première ministre
Charlotte CAUBEL, chargée de l’Enfance
Hervé BERVILLE, chargé de la Mer
Marlène SCHIAPPA, chargée de l’Economie sociale et solidaire et de la Vie associative
- Auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer :
Sonia BACKES, chargée de la Citoyenneté
- Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :
Laurence BOONE, chargée de l’Europe
Chrysoula ZACHAROPOULOU, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux
- Auprès du ministre des Armées et du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse :
Sarah EL HAÏRY, chargée de la Jeunesse et du Service national universel
- Auprès du ministre des Armées :
Patricia MIRALLES, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire
- Auprès du ministre de la transition Ecologique et de la Cohésion des territoires :
Bérangère COUILLARD, chargée de l’Ecologie
Dominique FAURE, chargée de la Ruralité.
Source : Elysée, 4 juillet 2022