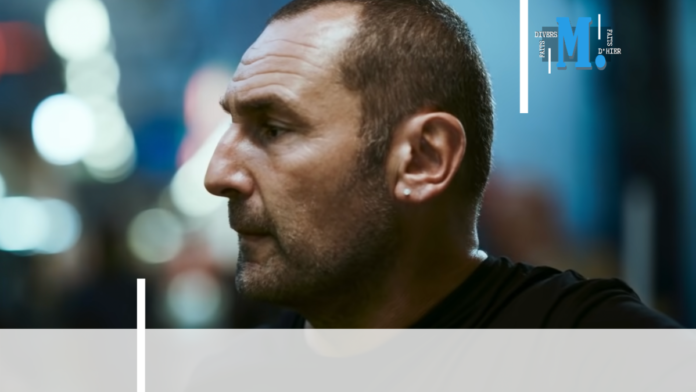Le 5 janvier 2021, des partisans de Donald Trump, président sortant des Etats-Unis, se réunissaient par milliers à Washington pour une manifestation (« Save America »), en réaction aux propos du président sortant des Etats-Unis dénonçant une élection truquée.
Le 6 janvier 2021, le temple de la démocratie américaine, le Capitole de Washington, est envahi par environ 800 manifestants pro-Trump déchaînés et convaincus d’avoir été lésés par la victoire de Joe Biden. C’est une tentative, incitée par le Président sortant, de bloquer la certification des résultats du vote du collège électoral de l’élection présidentielle de 2020 et donc d’empêcher la victoire de Joe Biden. Le Congrès est d’ailleurs en session à ce moment, effectuant le décompte des voix du collège électoral. Or, les résultats officiels vont confirmer que l’élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020 a vu la victoire du candidat démocrate Joe Biden sur le président sortant républicain Donald Trump avec 306 grands électeurs contre 232, avec plus de sept millions de voix d’écart au niveau national.
> A lire aussi : Tensions Russie-Ukraine : quelle est la situation ?
L’émeute se soldera par cinq morts, dont quatre militants pro-Trump et un policier, 140 policiers blessés et 1,5 million de dollars de dégâts. 700 émeutiers ont été inculpés, dont un condamné à cinq ans de prison ferme. Retour sur le contexte de cet épisode et les questions qu’il pose un an plus tard.
Y a-t-il eu préméditation ?
Une commission d’enquête spéciale du Congrès a été mise en place depuis juillet 2021 pour déterminer les responsabilités. Les premières auditions montrent que l’assaut était « planifié et coordonné », a fait savoir le chef de la commission, le sénateur démocrate Bennie Thompson. Donald Trump a réagi et demandé à la Cour suprême (6 juges républicains sur 9) de bloquer le transfert de documents à la commission. Il s’agit notamment des listes de personnes lui ayant rendu visite le 6 janvier 2021 dans la matinée. Ce 6 janvier, la famille de D.Trump et certains officiels républicains lui demandent d’intervenir pour arrêter l’intrusion dans le Capitole ; il réagit 187 minutes après le début de l’intrusion, appelant au calme en envoyant une vidéo d’une minute sur Twitter et concluant son message par un : « Rentrez chez vous, on vous aime, vous êtes extraordinaires. »
Quid de Donald Trump aujourd’hui ?
Un an plus tard, l’ancien président reste sur la même position : il estime que la victoire lui a été volée. Pour pallier le fait que ses comptes Twitter et Facebook ont été suspendus, il va lancer son propre réseau social Truth. Il a d’ailleurs prévu un meeting dans l’Arizona, le 15 janvier, où il devrait préciser ses intentions.
Il ne fait guère de doutes qu’il se représentera aux élections de 2024. Au sein du parti républicain, il est en train de placer ses représentants pour la prochaine élection des Midterms (élections à mi-mandat) qui vont se dérouler le 8 novembre 2022 et qui pourrait être une sorte de référendum ; du moins, elles seraient un moyen d’évaluer son niveau de popularité.
Comment se profilent les élections de 2024 ?
Les Midterms vont, bien sûr, donner une indication. Traditionnellement, ces élections à mi-mandat ne sont pas favorables au président élu. On constate aussi aujourd’hui une sorte de « flou » dans la politique américaine, extérieure comme intérieure. Les conditions du retrait d’Afghanistan n’ont pas vraiment arrangé les affaires de Joe Biden, et les Etats-Unis ont perdu de leur aura et de leur influence chez leurs alliés et dans le monde. En ce qui concerne la politique intérieure, il est trop tôt pour évaluer le bilan de Biden. Son projet, « Build Back Better » (« Reconstruire en mieux ») était ambitieux, mais les répercussions de ce plan se feront sentir sur l’économie en 2022. Le PIB serait en croissance de 6% après une contraction de 3.5%, avec quelques problèmes : l’inflation, les difficultés de recrutement pour les entreprises, et les pénuries de matières premières.
Comment les Américains considèrent-ils le paysage démocratique ?
Aux yeux des trois quarts des Américains (selon un sondage publié par ABC News le 2 janvier 2022), le 6 janvier a bien représenté une attaque contre la démocratie. Selon une enquête publiée le 5 janvier 2022 par le site Axios, environ 57 % des Américains estiment que des événements tels que ceux du 6 janvier 2021 sont susceptibles de se reproduire dans les années à venir, et seulement 55 % pensent que Joe Biden est le vainqueur légitime de la dernière élection. Dans une autre étude menée par la chaîne CBS News, un tiers des Américains considèrent que l’usage de la force peut parfois servir à défendre les idées démocratiques.
Les inquiétudes sont vives autour de la prochaine élection présidentielle, tant dans la presse que parmi les experts. Selon le juriste Richard Hasen, professeur à Irvine à l’Université de Californie “Il y a un risque réel que la présidentielle de 2024 et d’autres futurs scrutins aux États-Unis ne se déroulent pas de façon régulière et que les candidats élus ne reflètent pas le libre choix des électeurs. »
Les forces en présence
Aujourd’hui, les démocrates sont majoritaires à la Chambre des Représentants. Le problème est au Sénat où les Démocrates sont, certes, majoritaires mais d’une voix seulement. Il suffit donc que Joe Manchin, sénateur de la Virginie occidentale (connu pour ses opinions conservatrices) vote contre le programme « Build Back Better » pour que celui-ci soit bloqué. Or, le président des Etats-Unis doit gouverner avec les trois chambres, donc, l’équilibre est très fragile.
Par ailleurs, la cote de popularité de Joe Biden (tout de même âgé de 79 ans) s’élève à 44%. La vice-Présidente Kamala Harris reste discrète, parfois effacée (sa cote est de 35.6%.) Pourrait-elle reprendre le flambeau en 2024 ? Il est trop tôt pour épingler des prétendants à l’investiture démocrate. On parle de Pete Buttigieg, actuel ministre du Travail, de Beto O’Rourke, gouverneur du Texas et de Gavin Newsom, gouverneur de Californie.
Chez les Républicains, Donald Trump a « verrouillé » le parti et s’annonce comme le candidat républicain pour 2024. Les autres postulants potentiels, comme Ron DeSantis, gouverneur de Floride ou Mike Pompeo, ancien secrétaire d’Etat, ne semblent, a priori que des imitateurs.
Environ la moitié des Etats dans lesquels au moins un membre de la Chambre des représentants sera élu en 2022 (Midterms) viennent d’achever le redécoupage de leur carte électorale. D’après une analyse du 13 décembre 2021, citée dans L’Opinion et réalisée par le Wall Street Journal, dans les 22 Etats qui ont terminé ce redécoupage, le nombre de circonscriptions où le parti conservateur est très majoritaire est passé de 64 à 77, tandis que, du côté démocrate, il est passé de 61 à 59.
Il faut attendre les Midterms pour avoir une idée précise du panorama politique américain. Entre-temps, Joe Biden se doit de rassembler son camp et de convaincre les Américains du bien-fondé de sa politique intérieure. Au niveau international, il faudra effacer le désastre afghan et restaurer la confiance chez les alliés des Etats-Unis, plus particulièrement en Asie. Toute cette évolution sera, bien sûr, observée et commentée par Donald Trump qui continuera à peaufiner sa stratégie pour les élections à venir.
Alain BOGE
Alain Bogé est spécialisé en Géopolitique, Relations Internationales et Commerce International. Il a notamment enseigné à l’Université Lyon 3 (IAE), à la Delhi University-Inde (School of Economics), à l’IESEG School of Management Lille-Paris. Il donne actuellement des cours à la Czech University of Life Sciences-Dpt Economy-Prague, à la Burgundy School of Business (BSB)-Dijon et à la European Business School (EBS)-Paris.