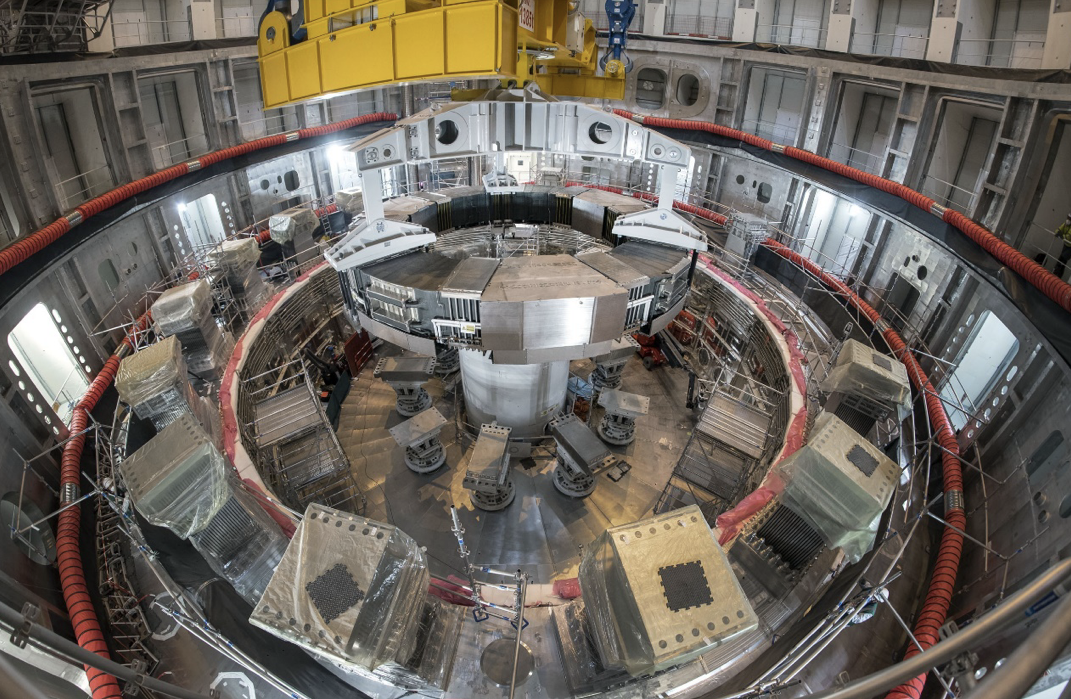Marc Charuel a été grand reporter pour Valeurs actuelles. Il a sillonné le monde, surtout comme correspondant de guerre. Il est l’auteur de nombreux livres : Les Cercueils de toile et Le Jour où tu dois mourir ont connu le succès. Chiens enragés a manqué, de deux voix seulement, le grand prix de la littérature policière. Son dernier roman s’intitule Le Disparu du Mékong et a pour cadre principal un pays que l’auteur connaît particulièrement bien, le Vietnam.
Marc Charuel a passé deux mois en Afghanistan en 1988, juste avant le retrait soviétique, avec l’un des groupes pachtounes qui allaient fonder le mouvement des Taliban. Puis en 2006 une semaine, lors d’une visite du ministre de la Défense de l’époque et enfin quinze jours en 2008, en opération avec le 8ème Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine juste après l’embuscade d’Uzbin (une patrouille française tombe dans une embuscade de Taliban). Il évoque pour Le Méridional son séjour en Afghanistan, avec des opinions singulières, parfois tranchantes.
> A lire aussi : Marc Charuel, ancien reporter de guerre (1) : en Afghanistan, les Taliban en germe sous les moudjahidines
Le Méridional : Les systèmes de contre-insurrection utilisés par les Américains s’inspirant des théoriciens français en Indochine et en Algérie ont-ils eu un impact quelconque ?
Marc Charuel : À mon sens, aucun. Parce que l’Afghanistan n’est ni l’Indochine ni l’Algérie, que ce soit sur les plans géographique, historique et culturel. D’ailleurs le résultat est là : les Américains y ont à la fois perdu beaucoup de soldats et la guerre. Il ne faudrait pas non plus oublier que les Français aussi ont perdu celle d’Indochine comme celle d’Algérie malgré ce qu’en disent nos militaires pour cette dernière. Comment pourrait-on vaincre d’ailleurs un peuple qui lutte chez lui pour sa liberté, quel que soit ce que recouvre ce terme ? À ma connaissance, cela ne s’est produit nulle part. Les insurrections menées par le Viêt-Minh, le FLN ou les Taliban auront été, quoi qu’on en pense, des guerres de libération. Maintenant, le problème est plus complexe avec Al-Qaeda ou Daech. C’est là que les méthodes de contre-guérilla peuvent trouver tout leur sens, avec plus ou moins de bonheur comme on l’a vu en Irak, en Syrie ou au Sahel. Reste que la page est toujours en train de s’écrire. Et personne n’en connaît encore l’épilogue.
LM : Sur le terrain, avez-vous pu constater une pratique différente entre les troupes françaises et les troupes américaines ?
MC : Je n’ai pas suivi les Américains. Je me garderais donc bien d’émettre un avis si ce n’est qu’ils ont certainement très mal formé l’armée afghane quand on voit comment celle-ci s’est débandée devant les Taliban ces derniers jours.
LM : L’Afghanistan est réputé être « la tombe des empires ». Qu’est-ce qui justifie selon vous cette sombre réputation, au regard de votre expérience ?
MC : Ce que je vous ai dit plus tôt. Aucun pays étranger n’a jamais pu y demeurer, ni les Anglais ni les Soviétiques, ni les Américains ni les Français. À chaque fois, tous balayés par des paysans en sandalettes. Pourquoi ? Parce que la culture afghane nous est si étrangère, en tout cas dans le pays rural, qu’il est impossible de rester. Même les ONG en ont fait la triste expérience. C’est un monde à part. Il suffit de relire Kessel pour s’en faire une idée.

LM : Que dire à propos de la ligne Durand, établie en 1893 entre l’Afghanistan et le Raj britannique ? Est-ce qu’une frontière différente aurait changé les choses ?
MC : Cela fait un peu penser aux frontières tracées sur la carte à grands coups de décimètre au moment des décolonisations africaines. Comme bien des ethnies en Afrique, les Pachtounes se sont retrouvés arbitrairement de chaque côté de cette ligne Durand avec pour conséquences que toutes les insurrections afghanes ont été soutenues par la communauté résidant au Pakistan. Ce qui a évidemment compliqué les actions militaires ou diplomatiques pour régler les crises. On peut en apprécier le résultat aujourd’hui. Ce n’est un mystère pour personne que les Taliban ont largement bénéficié du sanctuaire pakistanais grâce au soutien offert par les service secrets et une partie de l’armée de ce pays.
LM : Que vous inspire la situation actuelle du pays ?
MC : J’ai envie de dire : un profond dégoût. Les images de la chute de Kaboul ressemblaient à s’y méprendre au drame qui s’était joué en avril 1975 à Saïgon. Une fois de plus les Américains ont abandonné un pays sans état d’âme après avoir signé avec leurs ennemis des accords qu’ils savaient ne devoir jamais être respectés, comme en 1973 avec les Nord-vietnamiens. Comme à chaque fois, mais ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là, ils ont déclenché une guerre sans se préoccuper de la manière dont ils y mettraient fin, dans l’honneur et le respect des gens qu’ils auront obligés à collaborer. Une fois de plus, ils ont vendu du rêve et cela s’est terminé en cauchemar.
LM : Avez-vous évoqué ces expériences dans l’un de vos romans ?
MC : Un peu, dans Chiens enragés, où l’on suit un groupe de djihadistes français en Afghanistan, comme j’en avais rencontré moi-même en 1988 dans la région du Waziristân. Vraiment, un très mauvais souvenir !
Propos recueillis par Raphaëlle PAOLI