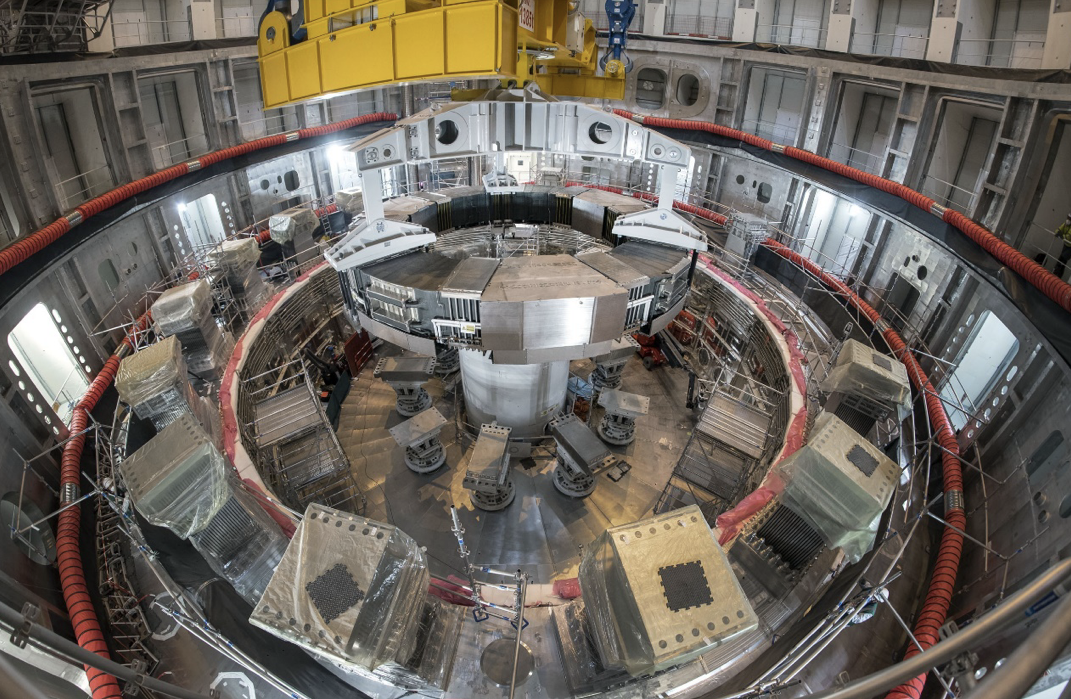Jean Pellegrino est un haut fonctionnaire communal qui a eu le privilège de servir successivement trois maires de Marseille : Gaston Defferre, en qualité de chef de cabinet du secrétaire général Jean Poggioli, directeur de cabinet de Robert-Paul Vigouroux et secrétaire général adjoint de Jean-Claude Gaudin. L’éminence de ces trois édiles a écrit ses mémoires dans un ouvrage numérique intitulé : « Un miroir au long de ma route », disponible sur « Librinova.com ». M. Pellegrino, l’homme de l’ombre, a bien voulu répondre en exclusivité aux questions du « Méridional ».
Le Méridional : Est-il exact que Gaston Defferre préférait l’avis de son chauffeur inculte à celui de polytechniciens venus de Paris pour lui présenter un projet national de voirie ?
Jean Pellegrino : Oui, c’est exact. Pour Defferre, son chauffeur représentait la voix du peuple. Le maire se méfiait viscéralement des « experts » dont il m’avait donné la définition suivante : « les experts, ou prétendus tels, ce sont des gens qui, AVANT, vous expliquent que ça ne peut pas survenir, et, APRES, vous démontrent que ça ne pouvait pas être évité… » Pour moi, cette définition demeure très pertinente : on peut la vérifier tous les jours.
Le Méridional : Pourquoi le conseil général des Bouches du Rhône, longtemps dirigé par Louis Philibert et Lucien Weygand (PS) a-t-il délibérément financé les communes du nord des Bouches du Rhône au détriment de Marseille ?
Jean Pellegrino : A la Libération, les élus socialistes aux affaires se sont partagé géographiquement les influences, donc les moyens qui étaient en leur possession. Ceux d’entre eux qui cherchaient à s’octroyer une parcelle de pouvoir étaient aussi de la partie. Dans notre département, on distinguait les « ruraux » et les « Marseillais ». Au-dessus de tous, chacun devait avoir l’onction du patron ombrageux, « le » chef marseillais incontesté : Gaston Defferre. Au fil des ans, de graves injustices ont été commises au détriment des Marseillais : par exemple le service départemental d’incendie et de secours a été intensément irrigué alors que le bataillon des marins pompiers de Marseille a dû se contenter de miettes.
Le Méridional : Pourquoi dites-vous qu’à partir de 1969 la passion de Defferre pour Marseille est allée decrescendo et qu’il a été obnubilé par une carrière ministérielle ?
Jean Pellegrino : Le maire mesurait le temps qui passait. Comme la plupart des socialistes de l’époque, Defferre a longtemps pensé que le gaullisme, perçu par eux comme illégitime, ne durerait pas au-delà de la fin de la guerre d’Algérie. Une guerre qui avait pourtant été déclenchée par leur parti au pouvoir, la SFIO. Désirant profondément redevenir ministre, après son cinglant échec présidentiel de 1969, Defferre a vu en Mitterrand une dernière chance d’accéder à un poste national. D’où son choix de tout miser sur l’aventure entreprise au congrès PS d’Epinay, l’alliance avec le parti communiste, le ralliement au « programme commun » et…la mise à l’écart sans ménagement de tous les opposants.
Le Méridional : Depuis cinquante-cinq ans et le slogan de Joseph Comiti : « on nous a volé la Canebière », Marseille hurle à l’invasion maghrébine et africaine. Le grand remplacement est-il en voie d’achèvement dans notre ville ?
Jean Pellegrino : La mutation démographique de Marseille, et de la France, est incontestable : elle saute aux yeux. Les « non communautaires », comme on dit à Bruxelles, sont ici majoritaires en nombre. S’agissant des jeunes générations, il suffit, pour s’en persuader, de se référer aux rapports de l’inspection académique sur les effectifs scolarisés. On peut y constater noir sur blanc les effets d’une immigration massive et continue depuis les années 60. Avec un probable record de France concernant le pourcentage d’élèves qui sortent du collège à douze ans et d’illettrés à seize ans. Le dernier inspecteur d’académie à qui je voulais parler du très bas niveau scolaire de Marseille, d’absentéisme et d’illettrisme m’interrompit pour me lancer : « ce que vous dites est interdit ! » On connait mieux aujourd’hui le règne du « pas de vagues » mortifère.
Le Méridional : Jean Pellegrino, vous êtes un cadre communal qui a loyalement servi trois maires aux caractères différents : Defferre, austère et cassant, puis Vigouroux, taiseux et itinérant, puis Gaudin, truculent et clientéliste. Quels étaient leurs petits secrets ?
Jean Pellegrino : Chacun d’entre eux préservait jalousement les siens. Ceux de Gaston Defferre avaient un lien avec ses bateaux, les secrets de Robert Vigouroux avaient trait à ses plaisirs de gourmet, de fumeur, de rencontres et de grand voyageur. Ceux de Jean-Claude Gaudin avaient peut-être un rapport avec sa maison de campagne à Saint-Zacharie…
Le Méridional : Vous décrivez une magouille inédite et grossière de Defferre sur les votes de 13000 militants socialistes marseillais qui avaient voté en 1979, avant le congrès de Metz, à 55 % en faveur de Rocard et 45 % pour Mitterrand. Résultat que Defferre a transformé le lendemain pour Solferino en : 5,5 % pour Rocard et 94,5 % pour Mitterrand. C’est la virgule qui tue. Comment une telle tricherie a –t-elle été possible ?
Jean Pellegrino : Cette manipulation des voix de militants au détriment de Rocard, je l’ai vue et entendue de mes yeux et de mes oreilles. J’étais présent en effet à une réunion à laquelle je n’aurais pas dû assister. Defferre était sous pression et il traitait ce jour-là divers dossiers communaux de nature différente. Il était encore le seul patron du Parti socialiste jusqu’à la rébellion, un peu plus tard, de Michel Pezet. Il a voulu faire vite et a minoré devant moi le pourcentage de Rocard et inversé le vote destiné à permettre à Mitterrand d’être le candidat du PS aux présidentielles de 81.
Le Méridional : Est-il exact que Gaston Defferre ait traité Robert Badinter, alors Garde des Sceaux, de « ministre sans couilles » ?
Jean Pellegrino : Oui, je confirme. L’expression assez virile de Defferre est aujourd’hui entrée dans l’histoire. Il est vrai que les deux hommes n’avaient aucune chance de se rencontrer. Les tensions et les incidents entre eux se sont multipliés. Defferre était furieux contre Badinter, le grand mandarin au silence méprisant qui le regardait de haut. Badinter, lui, fort de son aura parisienne et instigateur sanctifié de l’abolition de la peine de mort, ne voyait en Defferre qu’un provincial, pire, un « Marseillais ». Le journal France-Soir s’était fait l’écho de leurs disputes avec ce titre : « Justice-Police : la grande mésentente continue ». Pour Gaston Defferre, ce coup d’éclat qui ne manquait ni de courage ni de panache marqua, de fait, la fin de sa carrière à Paris.
Le Méridional : Pourquoi Defferre a-t-il institué en 1982 des « mairies de secteurs » qu’il appelait des « mairies de carton » dans sa loi électorale Paris-Lyon-Marseille ?
Jean Pellegrino : L’idée sous-jacente à ces « mairies de carton », c’était d’enlever la mairie de Paris à Jacques Chirac, alors maire tout-puissant de la capitale et bête noire de Defferre. Pour rassurer ses amis, Defferre avait trouvé cette image de « mairies de carton »…malgré leur coût de tour de Babel. A l’époque, le PS avait de l’imagination lorsqu’il s’agissait de sauvegarder ses intérêts. D’où l’idée saugrenue de découper la ville de Paris en vingt communes, une par arrondissement. Cette réforme suscita la réplique amusée de Jacques Chirac qui demanda : « laquelle s’appellera Paris ? » Devant le risque évident de ridicule, Mitterrand préféra reculer et il fit adopter une solution bâtarde, fruit pervers d’une pensée mauvaise. Ce fut la naissance de la fameuse loi PLM qui confirme l’unicité de la commune mais attribue aux mairies de secteur des bribes de compétences subalternes, avec une inflation inouïe du nombre d’élus. C’est ainsi qu’on est passé ici à Marseille de 63 élus à…303 élus, pour quoi faire ? Pour rien. Pour satisfaire un caprice partisan. Seul Raymond Barre, candidat à la présidentielle, avait promis d’effacer cette gabegie très coûteuse en emplois publics. Courteline demeure le prix Nobel indépassable de nos dirigeants.
Le Méridional : Pourquoi, au milieu de son sixième et dernier mandat, Gaston Defferre vous demandait-il de ne plus lui donner de notes sur le centre de Marseille qui devenait un bidonville et sur les territoires perdus du nord de la ville ?
Jean Pellegrino : La vérité, c’est que Defferre était à l’époque très occupé par la présidentielle de 1981 qu’il percevait comme une dernière chance. Il n’a pas vu le naufrage de la moitié nord et il n’a fait qu’entrapercevoir la dégringolade du centre-ville. Il créa bien une mission chargée de ralentir « l’orientalisation » de la Canebière mais il ne vit pas et ne pouvait pas mesurer l’ampleur du mal.
Le Méridional : Vous écrivez que Defferre est mort « officiellement » le 7 mars 1986 : est-ce à dire que vous connaissez la date réelle de son décès et les raisons de ce mystère ?
Jean Pellegrino : Defferre est probablement décédé cliniquement la nuit même de son accident. Le président de la République était en voyage à l’étranger quand il a appris l’hospitalisation de son ministre et il a voulu qu’on annonce son décès à son retour en France. D’où l’impression de flou laissée aux médias par les messages sibyllins des médecins sur l’évolution journalière de l’état de santé du maire.
Le Méridional : Est-il exact que c’est François Mitterrand lui-même qui a choisi Robert Vigouroux pour succéder à Gaston Defferre « parce qu’il parlait bien et avait une belle voix au téléphone » ?
Jean Pellegrino : Oui, c’est vrai. Cet épisode a été vécu par la collaboratrice la plus fidèle de Defferre, celle qui savait tout, sa secrétaire Simone Orsoni, à laquelle je rends hommage dans mon recueil. Après huit jours de disputes entre les divers prétendants du PS à la succession du vieux lion, le président Mitterrand demanda quel était l’homme qui lui répondait si bien et sans accent marseillais au téléphone lorsqu’il s’inquiétait de l’état de santé de Defferre. L’homme qui répondait au président n’était autre que Robert Vigouroux, chef du service de neurochirurgie, et en sus membre du PS et 13eme adjoint au maire. Les destinées historiques passent parfois par un simple coup de fil.
Le Méridional : Pourquoi estimez-vous que le talentueux Michel Pezet a raté le coche en votant le budget municipal présenté par Vigouroux en mars 1987 ?
Jean Pellegrino : En mars 1987, le vote du premier budget du nouveau maire n’était pas gagné d’avance car le socle électoral de Vigouroux ne reposait que sur une frêle majorité. Michel Pezet avait, comme le tambour d’Arcole, l’occasion de renverser le cours des choses en suivant la stratégie suivante : pas de budget voté, dissolution du conseil, nouvelles élections…Il ne joua pas l’audace folle du petit tambour. En tout cas, je restitue la scène telle que je l’ai vécue. J’avais les yeux rivés sur la pendule au-dessus de la porte du conseil et les interrogations défilaient dans ma tête : les oppositions, majoritaires, assisteront-elles au conseil ? Joueront-elles la chaise vide ? Décideront-elles de ne pas participer au vote du budget ? Iront-elles jusqu’à voter contre ce budget ? J’ai vécu ces moments avec une intense émotion, celle que ressent une personne que l’Histoire invite à sa table. Je n’en ai jamais parlé à Michel Pezet et j’ignore sa propre analyse de ce vote historique.
Le Méridional : Robert Vigouroux a-t-il réussi un grand chelem aux municipales de mars 1989 parce qu’il avait été exclu du PS trois mois plus tôt par Lionel Jospin ?
Jean Pellegrino : L’exclusion de Robert Vigouroux, annoncée à Marseille par le sombre Lionel Jospin fut mal reçue par beaucoup de Marseillais, socialistes ou pas. De nombreux visiteurs, connus ou moins connus, défilèrent dans mon bureau pour me confier qu’ils voyaient là une preuve que Vigouroux était bien étranger à un parti alors décrié pour ses magouilles et ses tripatouillages, y compris très haut dans sa hiérarchie…
Le Méridional : Dans votre opus, vous êtes sévère avec un ministre à bigoudis « qui émerveillait les gogos, ses copains de mœurs et d’affaires ». S’agit-il bien de Jack Lang ?
Jean Pellegrino : Oui, c’est bien de Jack Lang que je parle. Je lui reprocherai toujours son goût pour les mondanités entre copains, ses coups médiatiques, son sens du vent démagogique et au-dessus de tout, son indifférence à l’égard des petits, des banlieues, des enfants du peuple, bref de ceux qui ont le plus besoin de culture. Il n’a jamais rien fait pour répandre le livre dans les banlieues alors qu’ici avec le dévoué Marcel Paoli on a créé un réseau de bibliothèques et une douzaine de théâtres. Pourtant, nous partions de zéro avec des moyens limités. Les spectacles décentralisés de théâtre et d’opéra, l’Odéon sauvé de la destruction, Bonneveine et sa médiathèque, le théâtre du Merlan et sa bibliothèque entourés de 10 000 HLM, ce n’est pas Jack Lang, c’est nous.
Le Méridional : Pourquoi Gaudin a-t-il refusé de financer en 1995 l’agrandissement du port de la Pointe Rouge voté par Vigouroux, ce qui coûta plus d’un million d’euros de dédommagement versés à l’entreprise chargée des travaux ?
Jean Pellegrino : L’abandon de l’agrandissement du port de la Pointe-Rouge contre 80 millions de francs de l’époque versés à l’entreprise chargée des travaux, n’a jamais été expliqué. Le projet était financé, adopté, bouclé, le contrat signé…Un vrai mystère. L’idéal serait d’y revenir.
Le Méridional : Pourquoi Gaudin et sa majorité ont-ils soutenu et financé la villa Vauzelle, un caprice de 80 à 90 millions d’euros qui prend l’eau de toutes parts et ne sert à rien ?
Jean Pellegrino : La réponse est tragi-comique. Pour participer à la construction du Mucem, le président du conseil régional, Michel Vauzelle (PS) a exigé que la villa Vauzelle soit édifiée DEVANT le Mucem. C’était la condition sine qua non à la contribution financière de la Région Sud. Je n’ai jamais vu ça de ma vie ! Les élus marseillais se sont donc inclinés devant ce caprice dispendieux : ils ont financé la villa Méditerranée en sachant que c’était un doublon inutile. C’est un vrai scandale national.
Le Méridional : Pourquoi la création du port de Fos a-t-elle été une tragédie pour Marseille ?
Jean Pellegrino : Fos, c’est un beau rêve évanoui. La mairie, le tout-Marseille du commerce s’imaginaient voir naître Singapour à leur porte. Et en devenir la capitale…Or, pour une foule de raisons, les activités créatrices de milliers d’emplois ne vinrent pas. Une usine lorraine a été transférée sur place mais elle est demeurée, avec un gros port pétrolier, chiche en emplois. Le centre directionnel de la Bourse ne vit jamais le jour. Le rêve passa. Et nous restâmes en deuxième division.
Le Méridional : Marseille, selon vous, demeure la ville « des projets inaboutis » : à quoi attribuez-vous cette absence d’ambition ?
Jean Pellegrino : L’expression « ville des projets inaboutis » vient d’un de nos préfets qui énumérait devant moi les demi-échecs de projets à demi rêvés : le Frioul et son village grec, le centre directionnel de la Bourse avec son World Trade Center, la zone d’action concertée de Saint-Just, la Pointe-Rouge inachevée, un nouvel Hôtel de ville, la zone d’urbanisation prioritaire numéro 3, au nord-est de la ville, la seconde rocade retardée en permanence par les caprices démagogiques de certains élus. Entre autres exemples de projets que nos élus n’avaient pas la force ou l’ambition de porter jusqu’au bout.
Le Méridional : Pour quelle raison l’Europe n’a-t-elle financé aucune réalisation importante à Marseille alors qu’elle a subventionné, par exemple, tous les programmes régionaux de Rotterdam ?
Jean Pellegrino : L’Europe, c’est la plus grande frustration de ma carrière. C’est simple : tout se passe à Bruxelles comme si Marseille y était totalement inconnue. Sur place, le chef de cabinet d’un commissaire me l’a affirmé les yeux dans les yeux. C’est comme ça. On ne sait pas. On ne voit pas. On n’y va pas. On n’a pas de projet à y vendre. Nous restons un gros village au bord de l’eau, hors du système sanguin européen.
Le Méridional : Vous chiffrez à environ 450 000 personnes « extra-communautaires » la population qui colonise les quartiers nord de Marseille : cela signifie-t-il que la partition est acquise à Marseille ?
Jean Pellegrino : La partition évoquée ouvertement par notre ancien président comme un risque et une probabilité a été présentée comme un « séparatisme » par notre président actuel qui compte naïvement traiter ce phénomène de sécession par une loi. Quiconque, ici, prend le métro ou le bus, remonte la Canebière ou traverse le quai des Belges le soir venu est convaincu de la réalité de cette partition. Je me permets de vous rappeler un événement inédit dans notre République : l’accueil à la kalach du Premier ministre Emmanuel Valls aux marches des cités du nord de la ville : est-ce seulement imaginable dans un pays voisin ?
Propos recueillis par José D’Arrigo
Rédacteur en chef Le Méridional
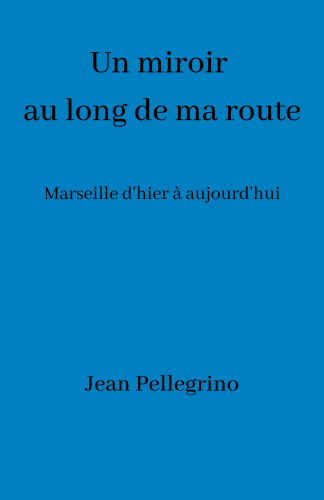
« Un miroir au long de ma route », Jean Pellegrino