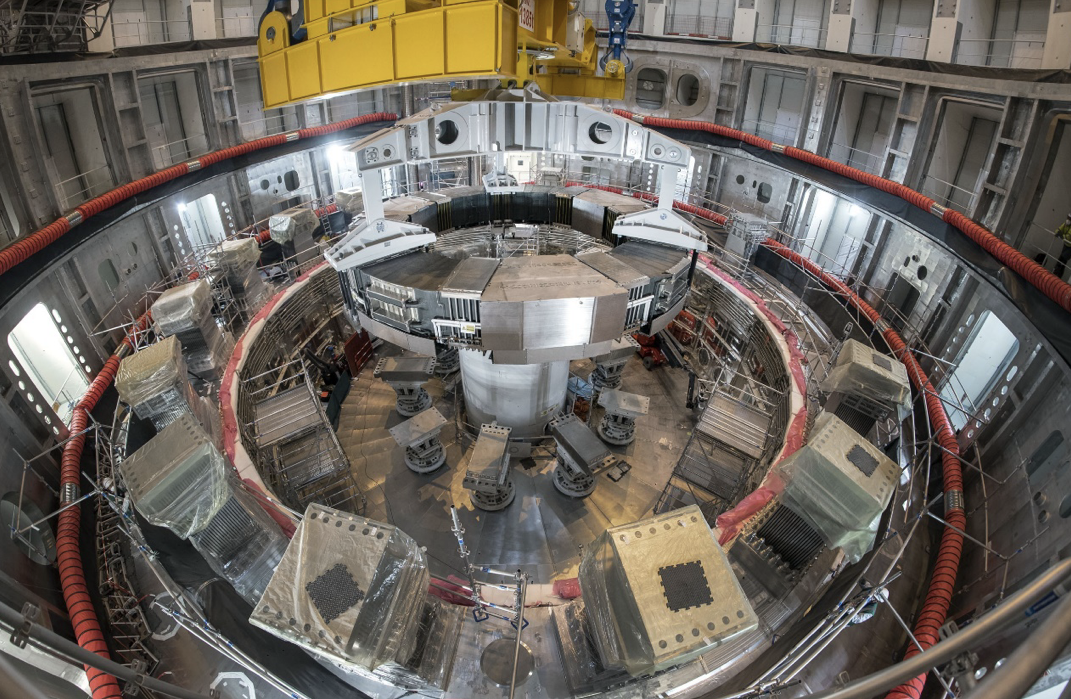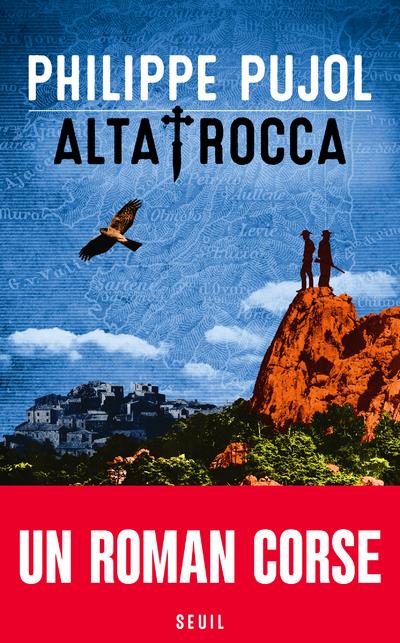Ne lisez pas ô¨ Alta Rocca ô£ le roman de Philippe Pujol, allez plutûÇt en CorseãÎ
Il est rare que je renonce û lire un livre : aprû´s tout, je suis un professionnel, et je garde lãespoir de trouver une pûˋpite, aussi petite soit-elle, dans la plus infûÂme daube.
Pourtant, le premier roman de Philippe Pujol, Alta Rocca, mãest tombûˋ des mains. Plusieurs fois. Jãai dû£ puiser profond dans ma conscience professionnelle et mon amour de la Corse pour mãobstiner dans ce galimatias prûˋtentieux. Je suis allûˋ au bout, comme le catenacciu va au bout de son calvaire : avec la sensation des chaûÛnes pesant sur mes paupiû´res.
Pourtant, jãaime bien Philippe Pujol, natif de Paris. Il est le reprûˋsentant le plus pur, en France, de ce que les Amûˋricains appellent le ô¨ gonzo journalism ô£, dont Bill Cardoso et Hunter S. Thomson furent les pû´res fondateurs : un journalisme û la premiû´re personne (lãûˋgo du rûˋdacteur y occupe souvent plus de place que lãinformation), une ûˋcriture au vitriol, et un engagement politique assez fort pour excuser toutes les dûˋformations possibles de la vûˋritûˋ.
Cette tendance chez Pujol au ô¨ Je ô£ ostensible fait sourire les vrais professionnels, qui lãexcusent, vu son talent pour dûˋbusquer les faits. Cãest ainsi quãil a dûˋcrochûˋ le trû´s prestigieux Prix Albert Londres en 2014 pour son enquûˆte sur les rûˋseaux de trafic de drogue dans les Quartiers Nord de Marseille, enquûˆte qui nourrit les premiers de ses livres, French deconnection et la Fabrique du monstre, dont jãavais en son temps dit tout le bien que je pensais. Jãavais mûˆme interviewûˋ lãauteur, qui û lãûˋpoque restait joignable, lãhubris ne lui ayant pas encore altûˋrûˋ le jugement.
Deux livres coups de poing ã cãest la caractûˋristique du gonzo. Mais lãultime resucûˋe de la mûˆme source, la Chute du monstre (2019) parut du rûˋchauffûˋ. Quãil nãait pas pensûˋ, par exemple, quãil y avait û Marseille un problû´me prûˋgnant liûˋ û lãislamisme mãavait paru curieux.
Entre-temps, notre pourfendeur de bien-pensance (laquelle est forcûˋment de droite, dans lãunivers manichûˋen de lãauteur, quand nous savons pourtant que le politiquement correct est de gauche) avait pris û partie son cousin germain, suspect de ne pas ûˆtre de son bord (Mon cousin le fasciste, 2017 ã la maman de Philippe mãavait un jour confiûˋ tout le mal quãelle pensait de cette offense û la solidaritûˋ familiale).
On sentait bien la tentation de la fiction dans les histoires de plus en plus fictionnalisûˋes que racontait Pujol. Son livre sur lãavenir du systû´me hospitalier, que je ne saurais trop conseiller (Marseille 2040), allait dans le mûˆme sens, bûÂtissant une dystopie grinûÏante, cãest-û -dire un monde utopique trû´s sombre, en tenant compte de lãûˋvolution des politiques de Santûˋ.
Jãai donc achetûˋ avec une certaine confiance Alta Rocca, prûˋsentûˋ comme le premier vrai roman de Pujol. Je nãaurais pas dû£.
On ne voit pas les scû´nes
En deux mots, des clans de bergers et de criminels variûˋs sãaffrontent sur les hauts plateaux du Cuscionu dans les annûˋes 1850-1870. Quelques allusions û la guerre de Crimûˋe ou û lãincursion franûÏaise au Mexique servent de repû´res historiques û une histoire empreinte de sauvagerie qui aurait aussi bien pu se passer il y a quatre siû´cles.
Les ô¨ pozzines ô£ ã ces trous dãeau, traces dãanciens lacs, qui dans quelques millions dãannûˋes deviendront de la tourbe ã et les blocs de granit nãont pas changûˋ depuis des millûˋnaires dans ces plateaux balayûˋs de tempûˆtes. Mais enfin, si vous voulez en savoir davantage, autant vous munir dãun bon guide (celui de Gallimard est certainement le meilleur ã dãailleurs, cãest moi qui lãai ûˋcrit) ou dãun bon bûÂton en escaladant lãIncudine.
Parce que cãest lû que pû´che le plus le roman de Pujol. Il a beau accumuler les noms de lieux, vous faire parcourir les ronciers ou allumer un feu dans une grotte, on ne voit pas les scû´nes.
Connaissez-vous lãhypotypose ? Cãest le terme que lãon emploie pour caractûˋriser la capacitûˋ dãun texte û vous faire voir un paysage ou une scû´ne. En deux mots, Mûˋrimûˋe (que Pujol cite, et û qui il a empruntûˋ le nom de son hûˋros principal, Orso) donne û voir aux lecteurs de Colomba, en 1840, des paysages dont ils ignoraient tout. Et Pujol peine û faire vivre les lieux û quelquãun qui a parcouru tous ces sites û maintes reprises.
Des personnages, nous ne connaissons pas grand-chose, sinon leur dûˋsir forcenûˋ dãen venir aux mains : chez Pujol, chaque balle tue tout de suite, le moindre coup de couteau est mortel, et on casse la tûˆte dãun ûÂne dãun coup de masse, en une fois (pour avoir assistûˋ le boucher de La Porta, sur le site de Campo Morada oû¿ il avait installûˋ son abattoir, quand jãûˋtais encore enfant, je sais que pour assommer un béuf, il faut une bonne dizaine de coups dãune masse de fer ã Pujol aurait dû£ sãy frotter).
Tous des ûˋjaculateurs prûˋcoces
Il nãy a pas que les bûˆtes qui sont maltraitûˋes. ô¨ Les viols ne prirent pas longtemps et se conclurent au couteau ô£, ûˋcrit-il. On en conclut que les bandits ûˋtaient tous des ûˋjaculateurs prûˋcoces ã une image dûˋtestable dans un roman historique corse.
Le rûˋcit, malgrûˋ les ûˋchauffourûˋes sanglantes entre gendarmes et bandits (oû¿ Pujol a-t-il trouvûˋ le terme de ô¨ bandites ô£ pour dûˋsigner les femmes desdits bandits, alors quãun journaliste qui en 1890 avait visitûˋ le cûˋlû´bre Antoine Bonelli, dit Bellacoscia, dans son ô¨ palais vertô£ du maquis, avait dûˋcrit un troupeau de femmes maintenues par le patriarche dans un ûˋtat de quasi-esclavageãÎ), est trop mince pour nourrir 283 pages ã jamais court livre ne mãa paru si long…
Alors Pujol lãagrûˋmente dãun insert sur lãaffaire des gardes corses du Vatican en 1662, ou de lãûˋcho laissûˋ par Pascal Paoli en Angleterre et aux Etats-Unis : û ce propos, je signale û notre nûˋo-romancier que Rousseau et son Projet de Constitution pour la Corse furent la source commune de la ô¨ rûˋpublique ô£ installûˋe û Corte dans les annûˋes 1760 et de la Constitution amûˋricaine. Paoli ûˋtait bien moins ô¨ corse ô£ quãhomme des Lumiû´res ã et accessoirement franc-maûÏon, un trait qui sous-tend le texte de Pujol. Les Frû´res auraient-ils accueilli en leur sein un homme û lãEgo si dûˋcomplexûˋ ?
Le pire, cãest le style, terriblement ampoulûˋ. ô¨ Nous connaissons tous les deux la vie dãOrsãAntonu, non que nos secrû´tes mû´res nous lãaient racontûˋe, ni mûˆme notre fantasque pû´re lui-mûˆme ã dont les secrets se noyaient sous dãûˋpiques rûˋcitsãÎ ô£ Lãantûˋposition de lãadjectif, en franûÏais, marque la charge de subjectivitûˋ (par opposition û un adjectif postposûˋ rûˋputûˋ objectif : ainsi comprend-on ô¨ un beau ciel bleu ô£). Pour ce qui est de lãaffichage de la subjectivitûˋ et des mûˋtaphores ronflantes (ô¨ lãorniû´re de son destin ô£ ou ô¨ le destin ûˋtait une balle perdue ô£ !), Alta Rocca y va fort.
Un dernier point. Ils nãont plus de correcteurs, au Seuil ? ô¨ Pallier û ô£ (p.203) nãest pas dãun franûÏais exquis. Et la troisiû´me personne du singulier du verbe ô¨ sãenfuir ô£ au passûˋ simple est ô¨ il sãenfuit ô£ ã pas ô¨ il sãenfuya ô£ (p.206).
Jean-Paul Brighelli
Philippe Pujol, Alta Rocca, Seuil, 19ã˜.