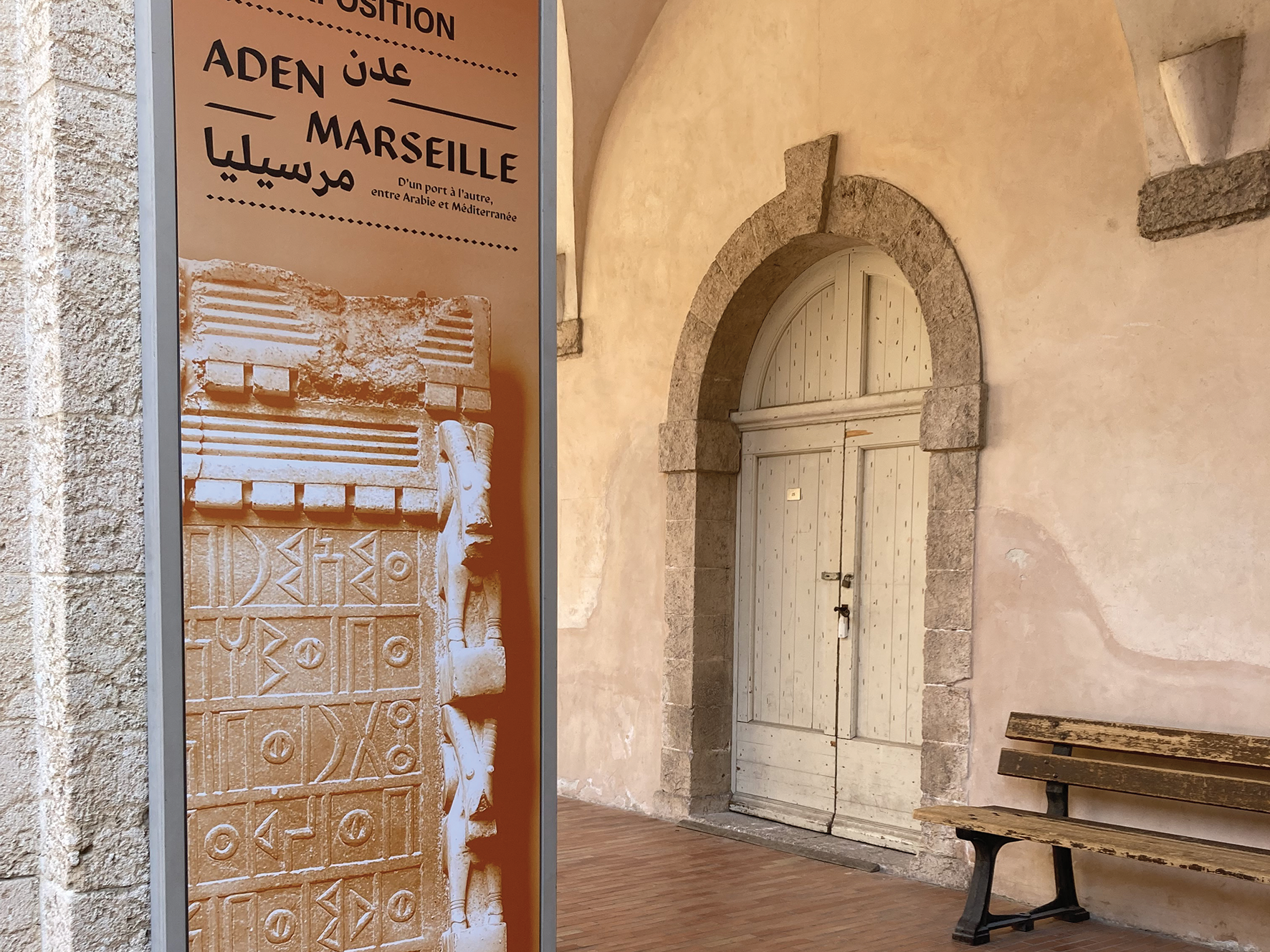Sur lâavenue du 24 avril 1915, ils nâont pas fait que commÃĐmorer. BenoÃŪt Payan, Martine Vassal, Renaud Muselier, Bruno Retailleau : quatre voix pour dire que lâhistoire armÃĐnienne est une affaire française. Et quâà Marseille, la mÃĐmoire nâest pas un ornement. Câest un combat.
Avenue du 24 avril 1915. Le nom dit tout. Ici, la mÃĐmoire est inscrite dans lâasphalte. Ce 24 avril, cent dix ans aprÃĻs le premier gÃĐnocide du XXe siÃĻcle, Marseille nâa pas seulement rendu hommage. Elle a parlÃĐ haut, clair, et à la premiÃĻre personne.

DÃĻs les premiers mots, le ton est donnÃĐ. BenoÃŪt Payan pose lâacte. Ce matin, dit-il, ÂŦ câest un devoir sacrÃĐ qui nous rÃĐunit Âŧ. Son texte ne dÃĐroule pas une chronologie, il ÃĐrige une gÃĐographie du combat.
De lâArarat aux plaines du Caucase, de Byzance à Marseille, le maire de Marseille (DVG) trace une ligne continue. Celle dâun peuple debout, et dâune ville qui lui ressemble. ÂŦ Comme Marseille, toujours rebelles. Comme Marseille, toujours universels. Âŧ
Mais sous les images, le politique affleure. 23 prisonniers armÃĐniens à Bakou. Le bruit des bombes en Ukraine, à Gaza, en Syrie. Le maire nâÃĐlude rien. Il rappelle que la France a son mot à dire. Et que les villes aussi. Marseille agira, annonce-t-il.
En jumelage avec Erevan. En symbole : deux boussoles, lâune à Marseille, lâautre en ArmÃĐnie. Deux aiguilles tendues vers la fraternitÃĐ. ÂŦ Aujourdâhui, nous marchons dans les pas de Missak. Pour la libertÃĐ. Pour lâArmÃĐnie. Âŧ

Martine Vassal : âUne mÃĐmoire blessÃĐe mais deboutâ
Elle, ne lit pas lâhistoire dans les livres. Elle la porte dans la voix. Dans le coeur. Martine Vassal ne parle pas dâun peuple, elle parle de ses aÃŊeux. Des rescapÃĐs venus poser leurs valises à Marseille. Des silences qui pesaient plus que les mots. ÂŦ Ma grand-mÃĻre demandait à ma mÃĻre de renouveler sans faute sa carte de sÃĐjour Âŧ, dit la prÃĐsidente (DVD) du DÃĐpartement et de la MÃĐtropole. Peur sourde. Pudeur tenace. MÃĐmoire transmise par lâombre.
Mais cette mÃĐmoire-là nâest pas seulement blessÃĐe. Elle est ÂŦ debout Âŧ. Et aujourdâhui, dit-elle, elle appelle à parler. à raconter. à rompre le silence sur les dÃĐplacÃĐs du Haut-Karabagh, les prisonniers oubliÃĐs, les familles arrachÃĐes à leur sol. ÂŦ Le silence est assourdissant Âŧ, lÃĒche-t-elle.
Alors elle agit. Elle annonce la crÃĐation, dans le 11e arrondissement, dâun espace de mÃĐmoire vivant. Un lieu ÂŦ ouvert à toutes les gÃĐnÃĐrations Âŧ. Un lieu pour que transmettre reste une forme de rÃĐsistance.

Renaud Muselier : âNous ne sommes pas de ceux qui se taisentâ
Avec lui, le propos se durcit. Pas de digression. Le prÃĐsident (Renaissance) de RÃĐgion cogne là oÃđ ça fait mal. LâArtsakh vidÃĐ de ses habitants. Les ÃĐglises profanÃĐes. Les chancelleries muettes. ÂŦ Ce nâest pas un exode : câest un arrachement. Âŧ Et lâAzerbaÃŊdjan, dit-il, ne se contente pas dâavoir expulsÃĐ : il humilie, encore, dans ses tribunaux.
Renaud Muselier cite Martin Luther King : ÂŦ Le pire, câest le silence des gens bien. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se taisent. Âŧ Lui revendique le contraire. La RÃĐgion Sud a reconnu lâArtsakh, refusÃĐ la COP29 Ã Bakou, injectÃĐ de lâargent dans les ÃĐcoles, les universitÃĐs, les panneaux solaires. ÂŦ La fraternitÃĐ, ce nâest pas un mot. Câest un devoir. Âŧ
Et il salue Bruno Retailleau. ÂŦ Ce nâest pas un geste protocolaire, câest la continuitÃĐ dâun combat. Âŧ Celui de la vÃĐritÃĐ, de la fidÃĐlitÃĐ, de la souverainetÃĐ.

Bruno Retailleau : âLâArmÃĐnie est une cause françaiseâ
Le ministre dâÃtat referme la cÃĐrÃĐmonie avec des mots ciselÃĐs. Il dit que lâhistoire ÂŦ transcende la gÃĐographie, et les clivages partisans Âŧ; parle du souvenir, qui ÂŦ abolit la distance Âŧ, et de ces cris de vie poussÃĐs par les rescapÃĐs ÂŦ à travers vous, à travers nous Âŧ. Que ÂŦ les cÅurs français et les cÅurs armÃĐniens nâen forment quâun seul Âŧ.

Il ne sâen tient pas à lâhommage, en ÃĐvoquant les otages armÃĐniens dÃĐtenus ÂŦ injustement Âŧ, ÃĐvoquant le combat : pour la mÃĐmoire, contre lâoubli, pour la libertÃĐ, la souverainetÃĐ, lâintÃĐgritÃĐ de lâArmÃĐnie. Il exige justice pour les otages. Il rend hommage à ceux qui ont souffert, combattu, transmis. Et dans la derniÃĻre ligne, tout sâaligne : ÂŦ LâArmÃĐnie est une cause française. Âŧ
Narjasse Kerboua












![[Vox MÃĐridional]ObsÃĻques de Mehdi Kessaci : un adieu intime, un cri dâalerte pour une ville sous pression.](https://lemeridional.com/wp-content/uploads/2025/11/2019-12-09.jpg)