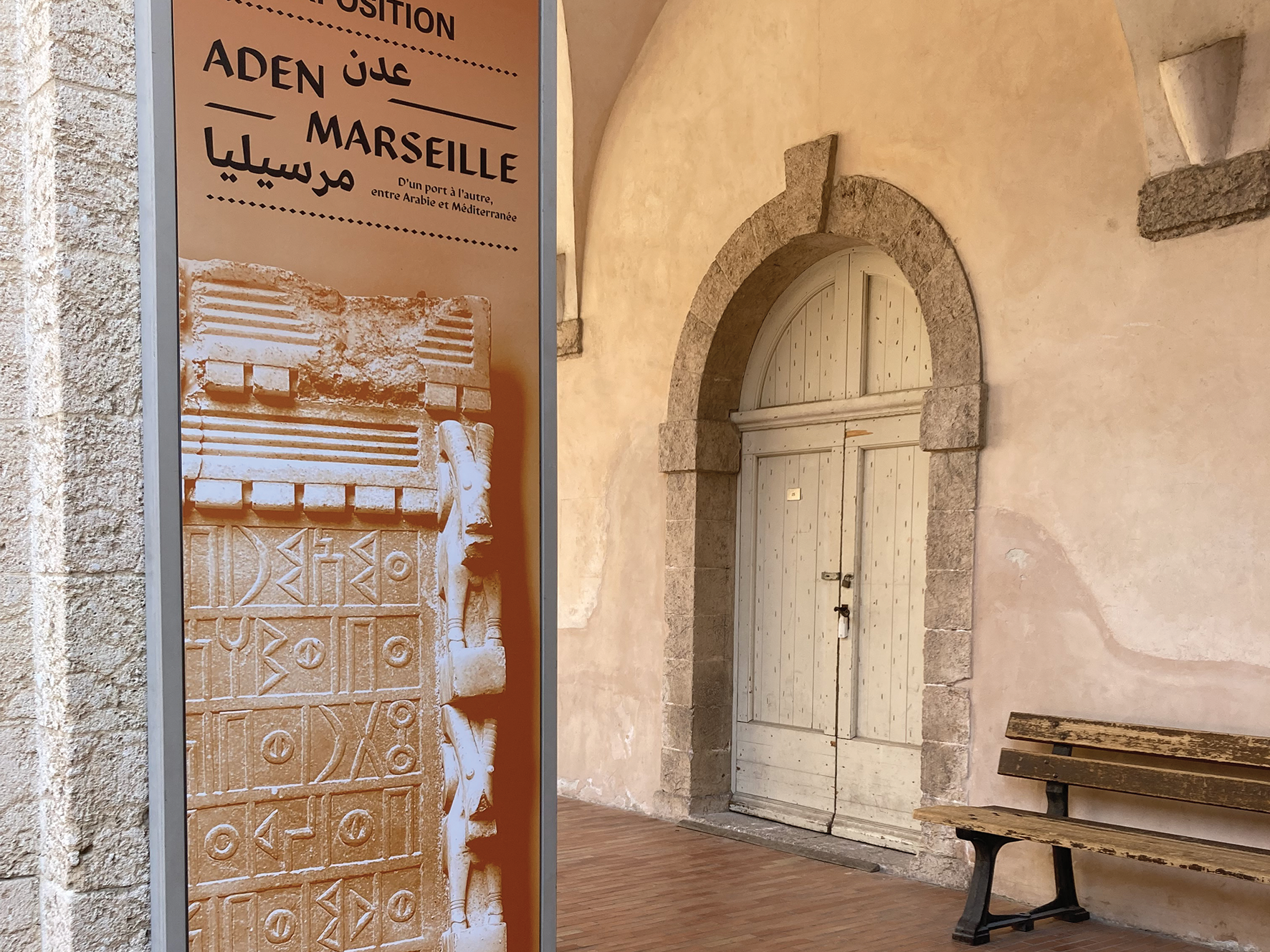À la veille du conseil municipal, l’opposition marseillaise sort la calculette et les critiques : 190 caméras installées, 500 financées. Pour Catherine Pila et les siens, la majorité a surtout filmé son propre immobilisme.
À Marseille, la sécurité reste un sujet inflammable. Jeudi, les membres du groupe d’opposition Une Volonté pour Marseille, présidé par Catherine Pila (LR), a présenté à la presse sa lecture critique de la mission d’information et d’évaluation (MIE) sur la vidéoprotection.
Une initiative qu’il avait lui-même sollicitée un an et demi plus tôt, dans l’espoir d’un état des lieux précis sur un dispositif jugé opaque. Le résultat ? Un rapport présenté comme incomplet, biaisé, et politiquement orienté.
Premier angle d’attaque : la composition même de la mission. Alors que le règlement intérieur du conseil municipal prévoit dix membres, la MIE en a compté onze. Une entorse passée sous silence, pour éviter que la procédure ne soit frappée de nullité, la loi interdisant d’en relancer une à moins d’un an des élections municipales.
Des caméras sans plan d’action
« Nous avons demandé cette mission parce que, pendant trois ans, nous n’avons obtenu aucun chiffre fiable sur la vidéoprotection », rappelle Catherine Pila. À la fin du mandat de Jean-Claude Gaudin, Marseille comptait 1 523 caméras.
Cinq ans plus tard, elles seraient 1 713, soit une progression de 190 unités, essentiellement concentrées sur les années 2022 et 2023, à l’occasion de grands événements. Une évolution qualifiée de marginale. « Et pourtant, ce matin, le maire de Marseille répondait à Bruno Retailleau qu’il y en avait plus de 1 700, comme s’il en était l’artisan », s’indigne l’élue LR.
Autre grief majeur : l’absence de méthode. Pierre Robin, conseiller municipal (LR) et membre de la mission, déplore le flou entourant le déploiement à venir de 310 nouvelles caméras, annoncé sans localisation ni justification technique. Et Sylvain Souvestre d’illustrer ce propos avec le cas de son secteur : « J’ai proposé 185 emplacements validés par la police nationale dans le 11e et le 12e. Je n’ai jamais eu de retour. »
L’opposition rappelle également que l’État s’était engagé à financer 500 caméras à hauteur de 80%. Faute de réactivité, la Ville n’en aurait installé que 190, le reste du financement ayant depuis été revu à la baisse, à 65%. « On avait la main tendue de toutes les collectivités – Métropole, Région, Département – mais on ne l’a pas saisie, souligne Sylvain Souvestre. Résultat : du temps perdu, et de l’argent public gâché. »
La révélation
L’absence de concertation est aussi pointée. Bruno Gilles (Horizons) revient sur le fonctionnement sous la précédente mandature. « Les caméras étaient implantées à la suite de réunions entre la police nationale, les fédérations de sécurité et les élus de secteur. C’était très encadré. » Ce dispositif aurait été abandonné, remplacé par une approche plus verticale. « Aujourd’hui, même les mairies de secteur ne sont plus consultées. »
L’ancien maire du 4e secteur évoque par ailleurs un cas emblématique : celui des caméras installées avenue des Chutes-Lavie, dans son arrondissement. À l’époque, elles avaient permis d’endiguer une série de braquages. « Et c’est l’une d’elles qui a filmé un individu en train de vider un chargeur de kalachnikov. Ces images ont été diffusées massivement. Sans cette caméra, il n’y aurait eu aucune preuve. »
La critique touche aussi à la profondeur du rapport. L’adjointe au procureur aurait, selon les élus, recommandé d’allonger la durée de conservation des images, actuellement limitée à dix jours à Marseille, l’un des seuils les plus bas de France. Une demande absente des conclusions. « Il n’y a eu aucun travail sérieux sur les comparatifs techniques, ni sur les coûts d’un allongement de stockage », ajoute Pierre Robin.
L’opposition dénonce une mission instrumentalisée
Enfin, les opposants dénoncent l’instrumentalisation de la mission. « L’adjoint à la sécurité [Yannick Ohanessian (PS), ndlr] a été nommé rapporteur, alors qu’il est directement concerné par le sujet. C’est un non-sens démocratique », estime Catherine Pila. Les membres de l’opposition affirment n’avoir eu accès au rapport final que la veille de son adoption. « Nous avons rédigé une note complémentaire pour faire entendre notre voix. »
Une voix d’autant plus critique que, selon Pierre Robin, certaines recommandations du rapport relèvent du réchauffé politique : « Tiens, en 2025, on découvre qu’on pourrait associer les mairies de secteur ou aller chercher des financements auprès des autres collectivités. C’est écrit noir sur blanc comme s’ils avaient eu une révélation, alors que ça fait quatre ans qu’on le propose. »
Après avoir inscrit un moratoire dans son programme de campagne, la majorité municipale revendique désormais le développement de la vidéoprotection. Ironie de l’histoire : c’est Bruno Retailleau, chef de file d’une droite sécuritaire, qui a salué le maire de Marseille pour son volontarisme sur le sujet. Il fallait oser, le Printemps marseillais l’a fait.
Narjasse Kerboua









![[Vox Méridional]Obsèques de Mehdi Kessaci : un adieu intime, un cri d’alerte pour une ville sous pression.](https://lemeridional.com/wp-content/uploads/2025/11/2019-12-09.jpg)