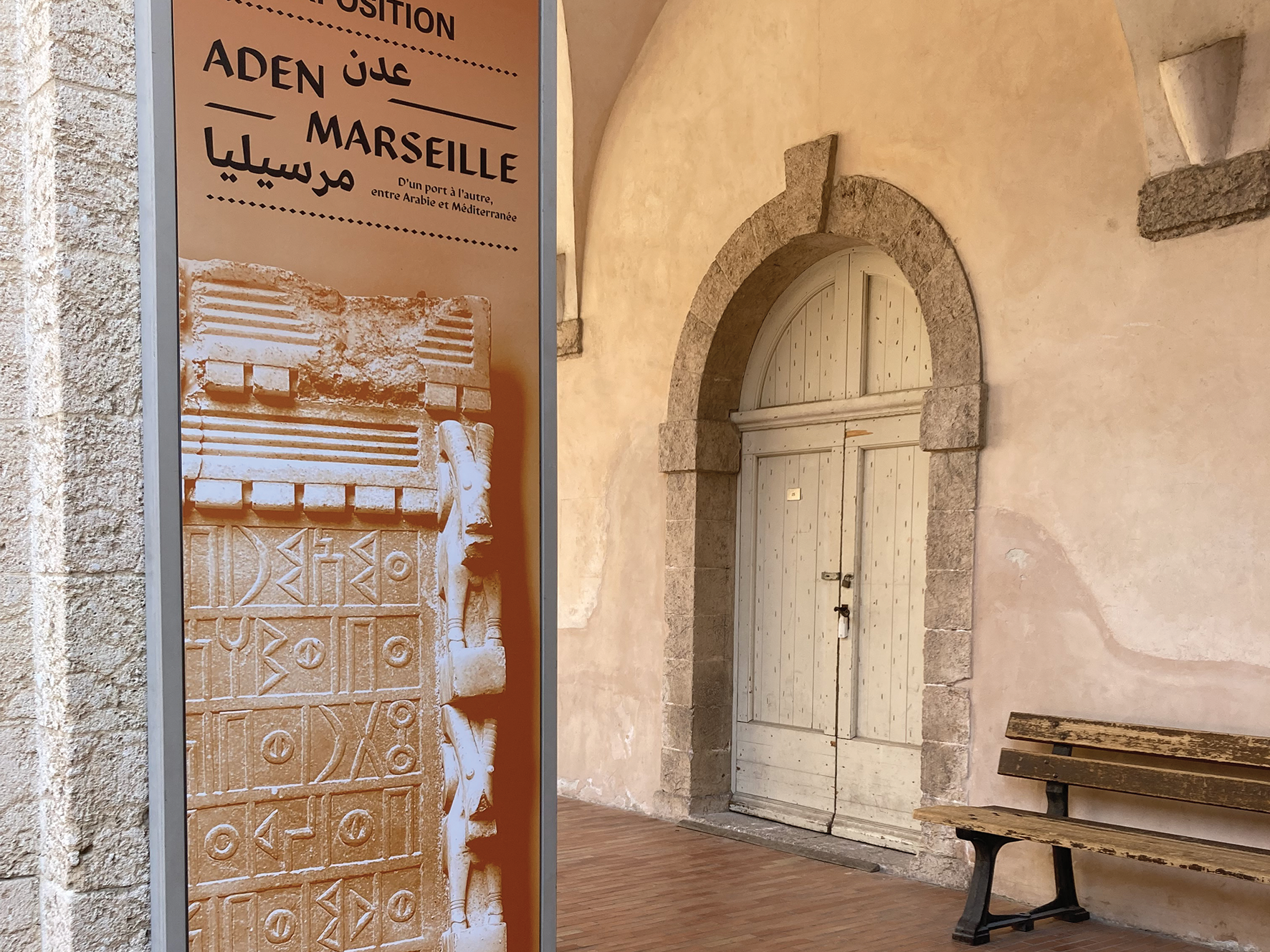Longtemps hostile à la vidéosurveillance, la majorité municipale assume aujourd’hui un virage sécuritaire. Le rapport d’évaluation du système en vigueur depuis 2011 dresse un constat sévère, mais valide en creux le principe d’un outil devenu incontournable. État des lieux d’un virage stratégique.
Promesse oubliée, doctrine floue, virage discret. La majorité municipale, jadis vent debout contre la vidéosurveillance, change de pied en pleine ligne droite électorale.
La mission d’information et d’évaluation, lancée en décembre 2024 à la demande du groupe Une Volonté pour Marseille, livre un verdict clair : la vidéoprotection, héritée des précédentes mandatures, a été déployée sans stratégie ni pilotage. Zones sensibles sous-dotées, caméras peu utilisées, usage centré sur les réquisitions judiciaires – loin de l’outil de prévention promis.
En 2020, la ville comptait 1 500 caméras. Plus d’un tiers étaient faiblement actives. Seulement 22% couvraient les arrondissements les plus touchés par l’insécurité (13e à 16e). Le tout pour un coût de 4,2 millions d’euros par an, rien que pour la fibre louée à 47%. À cela s’ajoutait l’absence d’indicateurs de performance et un pilotage morcelé entre la Ville, la Métropole et les prestataires.
Présidée par Éric Méry (Printemps Marseillais) et confiée à l’adjoint à la sécurité Yannick Ohanessian (PS), la mission a réuni toutes les sensibilités : de l’écologiste Fabien Pérez à Catherine Pila (LR), en passant par Samia Ghali (Marseille avant tout). Auditions, visites de terrain, analyse du rapport de l’Inspection générale des services… le travail, méthodique, a abouti à une série de constats largement partagés.
Du moratoire au revirement
Lors de son arrivée au pouvoir, le Printemps Marseillais avait promis un moratoire sur la vidéosurveillance – inscrit dans son programme de campagne – , refusé l’aide du Département et dénoncé un « œil sécuritaire » généralisé. Ce gel devait permettre une remise à plat. Il s’est traduit par du retard. Quatre ans de dogmatisme assumé, aujourd’hui balayé d’un revers d’objectifs chiffrés.
Depuis 2022, en effet, changement de cap. Porté par le plan « Marseille en Grand » et financé à 80% par l’État, un programme de redéploiement est enclenché : 500 nouvelles caméras sont prévues d’ici 2026, dont 190 déjà posées…
Les priorités ont évolué : abords des écoles, zones de trafic, grands événements. Le matériel aussi : vision nocturne, 360°, zoom longue distance, avec des postes déportés accessibles à la police nationale. La Ville revendique désormais plus de 4 000 flux vidéos actifs, contre 2 200 en 2020. Son centre de supervision urbaine (CSU) figure parmi les plus importants de France.
Un repositionnement sous pression électorale
Présenté au conseil municipal ce 25 avril, le rapport (point 27 de l’ordre du jour) acte cette nouvelle ambition et se veut fondateur : inventaire, gouvernance renforcée, comité d’éthique, coordination avec les mairies, transparence. Autant de leviers réclamés de longue date par l’opposition, longtemps ignorés par la majorité.
Ce revirement du Printemps Marseillais tient moins d’une conversion idéologique que d’un réalisme imposé par le terrain : violences, trafics, tensions scolaires. La vidéosurveillance, sans être une solution miracle, est devenue un outil fonctionnel. Et pour la majorité, désormais incontournable.
Reste une incertitude de fond : l’efficacité. Le rapport ne tranche pas. La BRI assure que 35% de ses enquêtes sont élucidées grâce aux images, mais les études nationales citées tempèrent ce chiffre, peinant à démontrer un effet dissuasif ou une amélioration significative des taux d’élucidation.
Sur le terrain, le constat est tout aussi nuancé. Certaines caméras ont été installées dès 2021 autour des points de deal. Mais les dispositifs peinent à s’imposer : 13 ont été abandonnés, 11 déplacées, 7 détruites. En 2023, 70 caméras ont été vandalisées. Plus de 40 dégradations sont déjà recensées depuis janvier.
Derrière ce repositionnement tardif, l’absence d’une doctrine claire depuis 2020 reste criante. Après avoir freiné, combattu, puis rattrapé son retard, la majorité tente aujourd’hui de reprendre la main. Mais pourquoi maintenant ? À un an des municipales, difficile de ne pas y voir un virage dicté autant par les circonstances… que par les échéances.
Narjasse Kerboua








![[Vox Méridional]Obsèques de Mehdi Kessaci : un adieu intime, un cri d’alerte pour une ville sous pression.](https://lemeridional.com/wp-content/uploads/2025/11/2019-12-09.jpg)