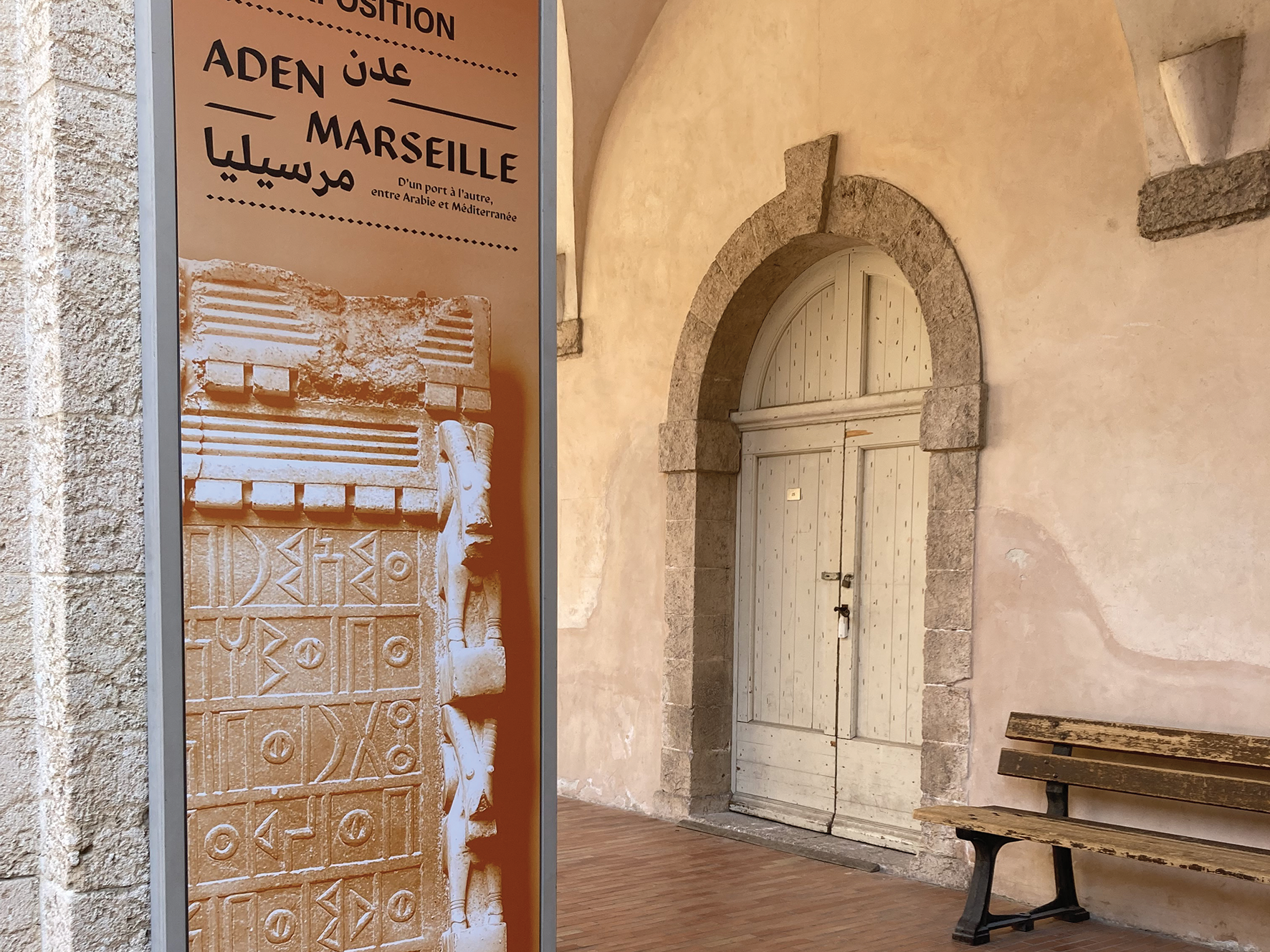En dĂ©placement Ă Marseille dans le cadre de sa campagne pour la prĂ©sidence des RĂ©publicains, Bruno Retailleau a dĂ©roulĂ© un discours dense, grave, dĂ©terminĂ©. Du fond, de la forme, et une certaine idĂ©e de la France – droite dans ses bottes.
Marseille, fin d’après-midi. Au Parc Chanot, la lumière est crue, les drapeaux tricolores s’agitent. Clap Your Hands de Kungs résonne dans les enceintes, comme un clin d’œil à une France qui applaudirait à nouveau la droite. L’entrée de Bruno Retailleau est saluée par des applaudissements nourris. Des « Bru-no ! Bru-no ! » scandés.
Petite salle mais comble. Environ 500 personnes. Sympathisants, militants, un noyau de fidèles : parlementaires et amis sénateurs, maires et cadres LR des Bouches-du-Rhône, mais aussi jeunes LR du 13, venus écouter celui qui veut « redonner à la droite une colonne vertébrale. » À condition d’être elle-même, et de retrouver le courage de croire à ses idées.

Une droite fracturée mais vivante
Le ministre de l’Intérieur parle à un parti « fracturé », « trahi », mais toujours debout. À Marseille, comme à La Grande-Motte ou Toulon, le prétendant à la présidence des Républicains déroule son propos comme un fil d’arpenteur. Tout est pensé. Ajusté. Aligné. Sans notes, mais avec méthode. Lentement, sûrement, avec cette gravité qu’il revendique.
D’entrée, deux dates comme points de repère : le 17 avril, dernier jour pour adhérer au parti ; le 17 mai, jour du vote. C’est sur ce tempo qu’il pose la première pierre, rendant hommage à ceux qui ont tenu bon. Ceux qui ont « tenu la ligne », les « militants du devoir », restés fidèles malgré les turbulences, les défaites, les trahisons.

« Le politiquement correct ? Je m’en fous »
L’objectif est clair : transformer cette fidĂ©litĂ© en espoir. La tonalitĂ© n’est pas Ă la conquĂŞte. Encore moins Ă la sĂ©duction, quoi que… Elle est Ă la reconstruction. Refondation mĂŞme !
Et derrière le mot « victoire », qui revient comme un leitmotiv, l’ancien président du groupe LR au Sénat évoque une volonté collective de réinscrire la droite dans le paysage. « Nous étions donnés pour morts », dit-il. La droite, alors, n’existait plus que dans les souvenirs attendris des commentateurs. « Il y a six mois, on était au fond du trou. Les journalistes nous parlaient comme à un patient en phase terminale. »
Depuis six mois, assure-t-il, la droite a repris sa place dans le dĂ©bat. Chaque jour, « nos idĂ©es sont discutĂ©es », rĂ©pète-t-il. « Il n’y a pas un jour sans que l’une des nĂ´tres fasse la une. » Il cite les victoires Ă©lectorales Ă Boulogne, Villeneuve-Saint-Georges, dans le Jura… comme des preuves que « l’élan s’est levĂ© », que les idĂ©es de la droite retrouvent leur Ă©cho.
Le responsable politique assume la polémique comme méthode, la franchise comme boussole. « Ce n’est pas une vertu, c’est ma force. » Ce qu’il appelle sa force et ce qui, dit-il, lui vaut de choquer. « Chaque semaine, ou presque, il y a une polémique. » Il les revendique presque une à une, comme autant de manières d’« enjamber le microcosme parisien », de s’adresser directement aux Français. « Le politiquement correct ? Je m’en fous. »
Aller au feu, sans se renier
Le cœur du propos se déploie autour de ce moment charnière qu’a été sa nomination au ministère de l’Intérieur. Le nouveau locataire de Beauvau parle d’un choix difficile, risqué, inconfortable. Mais nécessaire. L’enjeu, selon lui, n’était pas une place au gouvernement. Il s’agissait d’empêcher que le pays bascule dans les mains de la gauche radicale. Pour éviter que Macron donne les clés de la maison France à Mélenchon.
Et imaginer, pour mieux faire frémir, ce qu’aurait été l’alternative. À sa place ce samedi, lance-t-il, on aurait pu trouver « Monsieur Delogu ». Rires. Aux Affaires étrangères, peut-être « Madame Rima Hassan ». Au Travail, « ceux qui prônent le droit à la paresse ». Alors, face à ce scénario, pas d’hésitation. La droite, dit-il, a pris ses responsabilités.
Participer, c’était « aller au feu ». C’était ne pas se cacher. C’était faire « barrage », au sens presque mécanique du terme. « Quand on est de droite, on fait barrage à la gauche. C’est de l’ordre du réflexe. »
Comme une fonction biologique. Être de droite, dans sa bouche, c’est d’abord cela : se dresser, se tenir, faire écran. Pas question de transiger. « Je n’ai de la gauche que ma main », lâche-t-il, déclenchant les rires. Pour le reste, tout est droit. Droit dans ses bottes, droit dans sa ligne.
Le candidat Retailleau parle clair. Il appelle ça « parler vrai ». Ses formules sont rugueuses, sans détour, car la « politique crève depuis des années de l’insincérité », déplore-t-il.

L’ordre, le mérite, la nation
Sur le fond, son discours prend un virage plus dur. Sur l’immigration, Bruno Retailleau invoque « la proportion » et martèle : « Quand elle n’est pas maîtrisée, l’immigration n’est pas une chance. » Sur le voile, il dénonce « un étendard », « le symbole d’un projet politico-religieux. »
Concernant la justice des mineurs, le sénateur de Vendée plaide pour « des peines plus courtes mais exécutées immédiatement », fustige « l’impossibilisme juridique » et s’en prend aux « jurisprudences qui entravent », aux conventions internationales qui brident l’action. Et d’assumer la rupture : « Oui, je suis prêt à rompre avec le droit quand l’intérêt supérieur de la nation l’exige. »
C’est dans cet élan qu’il évoque l’Algérie. Il exige « la libération immédiate » de l’écrivain Boualem Sansal, s’agace d’« une repentance à sens unique », et affirme que « l’intégration n’a pas tenu ses promesses ». L’antiracisme, dit-il, « s’est parfois retourné contre la République », trahissant « son universalisme ».
À mesure que le discours avance, une ligne se dessine : celle d’une droite qu’il veut « verticale », attachée aux mots « devoir », « combat », « sacrifice ». Le chantre « d’une droite de convictions » préfère le choc à l’indifférence, la clarté aux compromis. Un discours contre les tièdes, contre « ceux qui se planquent », contre « ceux qui attendent que ça passe ».
L’État de droit ? Il est devenu, selon lui, « l’alibi de l’impuissance ». Alors il propose d’aller plus loin, de modifier la Constitution, d’en appeler au peuple : « Je veux réformer l’article 11 pour permettre au peuple français de s’exprimer par la voie du référendum sur la politique migratoire qu’il souhaite. »
Mais le discours de Chanot ne s’arrête pas aux seules lignes de fracture régaliennes. Il s’élargit à une critique plus large du modèle social et éducatif, en convoquant un autre mot totem : la méritocratie. À ses yeux, l’école est le « plus grand scandale français », celui d’une République qui « échoue à émanciper » et « trahit les promesses d’égalité ».
Alors il faut rétablir les fondamentaux, « refaire des maîtres », revaloriser le métier d’enseignant, rompre avec les « pédagogies soixante-huitardes » comme avec « les nouvelles lunes woke ». Et toujours ce même fil rouge : le refus du renoncement. L’école doit redevenir l’outil de l’ascension. Dans la même veine, il plaide pour un État stratège, une économie de production, pas de rente. Une France qui valorise le travail, l’effort, le mérite.

Reconstruire une maison politique
Pour que cette droite-là tienne la distance, elle doit, selon l’orateur du jour, retrouver une charpente, une structure capable de durer. « Déprésidentialiser le parti », lâche-t-il, appelant à plus de démocratie interne, plus de corps intermédiaires, moins de décisions prises au bon plaisir de quelques-uns. Un remède aux errements passés, et un vaccin contre ceux à venir.
Il parle de rĂ©armement moral. Mais pas seulement du pays – de sa propre famille politique. « Un parti populaire, moderne, patriote. » Qui ne radote pas, ancrĂ© dans le rĂ©el, reconstruit avec celles et ceux « qui n’ont jamais dĂ©sertĂ© », les militants, les Ă©lus de terrain.
Car c’est aussi une affaire de fidélité. Pas seulement politique, mais intime. À soi, aux siens, à une histoire. Quand il évoque sa nomination au gouvernement, il dit s’être fait deux promesses : ne pas se renier, ne pas tromper les siens. Il promet de continuer à « dire les choses telles qu’elles sont », sans céder aux facilités ni au confort du silence. « Sans se planquer. »
Dans la salle, les applaudissements tombent comme des validations. Pas de storytelling, mais un aveu. La gratitude comme moteur. Il parle de dette, de responsabilité. Et d’un goût de servir, intact. « Je veux donner le meilleur de moi-même. Je ne veux pas vous décevoir. »
La présidentielle ? Pas un mot mais tout, dans le ton, la composition, la gravité du propos, semble calibré pour cette ligne d’arrivée. L’ombre du match plane. Bruno Retailleau, lui, s’échauffe déjà .
Narjasse Kerboua








![[Vox Méridional]Obsèques de Mehdi Kessaci : un adieu intime, un cri d’alerte pour une ville sous pression.](https://lemeridional.com/wp-content/uploads/2025/11/2019-12-09.jpg)