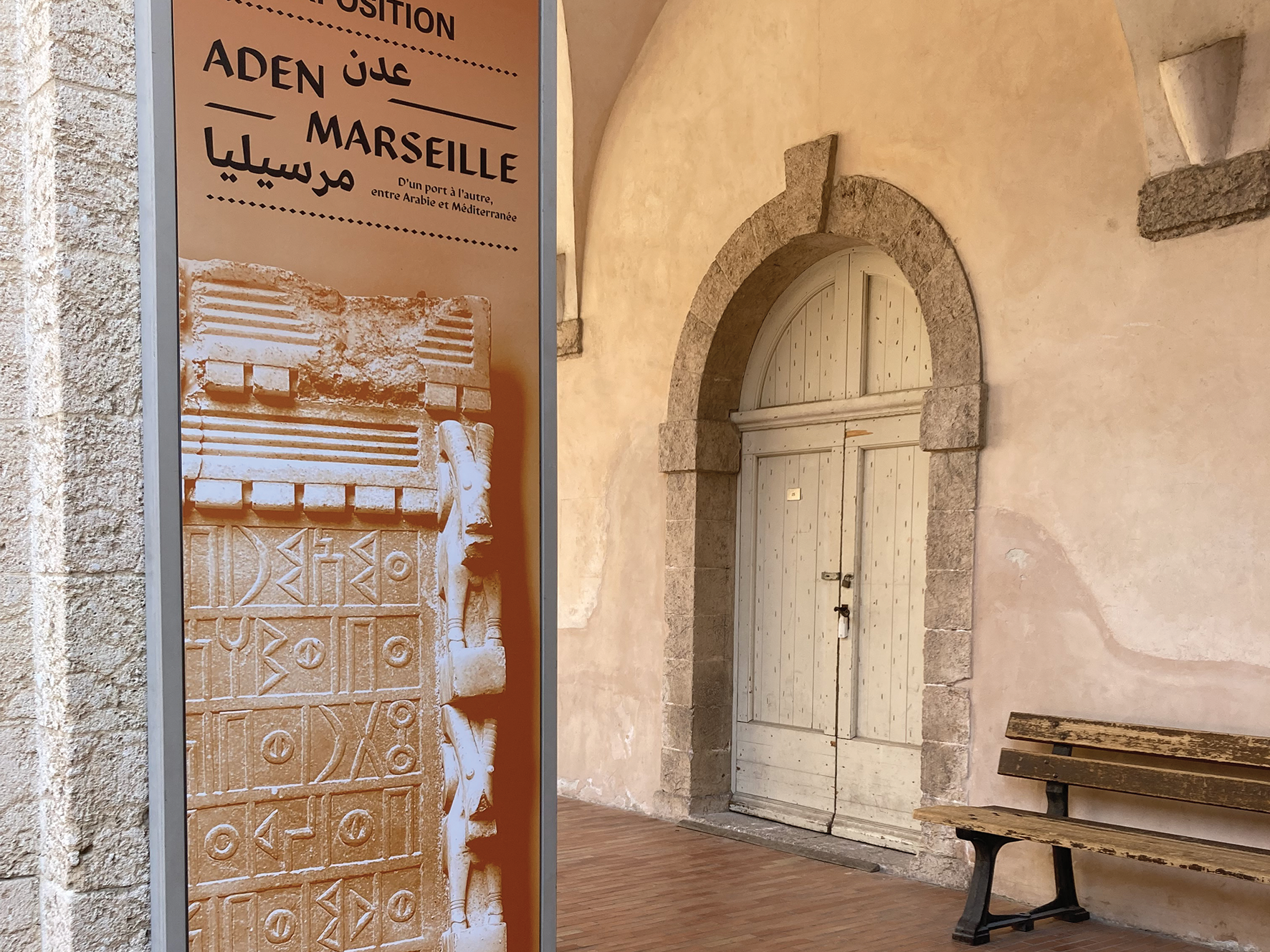Présent à Marseille pour le lancement du Parlement des Jeux d’hiver 2030, le rapporteur du Giec François Gemenne a tenu un discours franc et fort de 23 minutes pour enjoindre le territoire, et plus largement au monde de la montagne, à réussir à allier enjeux écologiques, d’enneigement et d’attractivité.
À l’initiative de la candidature commune des Alpes françaises du Nord et du Sud pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030, Renaud Muselier ne cesse de répéter son mantra : le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’appuie sur un projet sobre, avec de la neige et des chalets, et parle « depuis le premier jour du sujet environnemental ».
Après une étude commandée à Climsnow, et une autre à venir sur la gestion de l’eau, Renaud Muselier a convié François Gemenne dans l’hémicycle régional à Marseille pour le lancement de son Parlement des Jeux, en début de semaine dernière.
Chercheur et spécialiste de la géopolitique de l’environnement, il a coécrit le 6e rapport du Giec (Groupe d’experts d’intergouvernemental sur l’évolution du climat) en mars 2023 pour identifier les causes, impacts et mesures possibles à adopter face au changement climatique.
Nous retranscrivons ici son propos limpide, clair d’une vingtaine de minutes, ponctué d’une ovation, dont l’objet est de « voir dans quelle mesure ces Jeux de 2030 peuvent allier les impératifs écologiques plus présents et plus pressants que jamais, avec naturellement des enjeux économiques, de développement et d’attractivité pour la montagne dans son ensemble ». Verbatim.

LES ENJEUX
« Ces Jeux sont concernés par un double enjeu écologique. Le premier, c’est que, comme tout événement d’envergure, une empreinte carbone y sera associée. Bien entendu, l’idée n’est pas de faire des Jeux confidentiels dans une boîte mais de permettre à un maximum de spectateurs de les vivre en direct. Cette empreinte carbone est imputable en premier lieu aux déplacements des spectateurs et elle est également est liée aux installations. Je pense qu’on peut se féliciter du choix du Comité international olympique (CIO) de confier l’organisation des Jeux d’hiver l’année prochaine à Milan-Cortina et en 2030 chez nous, à des régions qui sont déjà équipées pour la pratique des sports d’hiver.
L’autre enjeu est spécifique aux Jeux d’hiver et traite de la question de l’enneigement. Nous le savons, et les dernières études parues dans les revues scientifiques, hélas, le confirment : même si nous respectons les objectifs de l’Accord de Paris, les glaciers alpins, comme pyrénéens du reste, sont condamnés. Nous savons aujourd’hui que le rythme de fonte des glaciers est plus important que jamais. Ce qui veut dire naturellement, que cela pose des questions très lourdes pour les écosystèmes locaux, également pour l’approvisionnement en eau potable.
Nous aurions tort de faire de ces Jeux olympiques une sorte de débauche finale de ski et de sports d’hiver avant un renoncement définitif
Nous aurions grand tort de vouloir nous cacher derrière notre petit doigt et de faire comme si ces deux enjeux étaient inexistants. Nous aurions tort de faire de ces Jeux olympiques une sorte de débauche finale de ski et de sports d’hiver avant un renoncement définitif.
Au contraire, je pense qu’il y a une autre voie à suivre, qui est précisément celle de nous demander comment nous allons pouvoir utiliser ce moment particulier, l’exposition qui lui sera donnée, la présence de visiteurs du monde entier, pour projeter un futur durable à la montagne, à l’ensemble de ses parties prenantes, depuis les exploitants de stations de sports d’hiver jusqu’aux agriculteurs, depuis la station de très haute montagne jusqu’aux villages des vallées, et de voir comment nous allons pouvoir inventer ensemble un nouveau modèle économique qui devra se fonder avant tout sur la durabilité. »
TROIS DIRECTIONS À POURSUIVRE
1 – « La première, c’est de faire la démonstration qu’il est possible de faire mieux. Je crois que c’est l’héritage principal que nous devons et que nous pouvons retenir des Jeux olympiques de Paris à l’été 2024. Bien sûr, il y a eu cette ambiance formidable, cette parenthèse enchantée, les émotions, les exploits sportifs, les médaillés et les déceptions.
Mais il y a eu surtout la démonstration qu’il était possible de faire mieux avec moins de carbone. La grande leçon des Jeux de Paris, c’est qu’il était possible d’organiser des Jeux qui, de l’avis général, étaient plus réussis que ceux des éditions précédentes, avec à la fois une empreinte carbone réduite et un budget qui est non seulement à l’équilibre, mais qui est même légèrement positif. »
Tout ce qui va pouvoir favoriser la coopération internationale va aller dans le sens de la lutte contre le changement climatique
2 – « La seconde direction que je voudrais vous inviter à suivre, c’est de réunir les gens. Nous sommes aujourd’hui dans une atmosphère de grande tension géopolitique. Où de plus en plus, il y a la tentation de se replier sur soi-même. Nous aurions tort de voir cela comme un particularisme américain. Nos sociétés européennes sont elles aussi gagnées par cette tentation. Je veux être très clair : la transition climatique et la transition écologique, on ne la fait pas uniquement pour soi-même. On la fait également pour les autres, pour ceux qui viendront après pour ceux qui habitent au-delà de nos frontières. Par nature, la transition écologique et climatique porte un projet universaliste.
C’est la réalisation des réalités de l’autre qui va faire en sorte que nous ayons envie de nous engager dans cette transition. Tout ce qui va pouvoir favoriser la coopération internationale va aller dans le sens de la lutte contre le changement climatique. Nous aurions tort de laisser de côté cet aspect. C’est un moment important qui nous permet de savoir pourquoi, au fond, nous sommes ensemble sur Terre et qu’il y a des moments où nous pouvons nous rassembler et célébrer ensemble les mêmes exploits et vibrer avec les mêmes émotions.
C’est important aussi à l’échelle de nos sociétés : il faut bâtir ces Jeux de manière aussi inclusive que possible. On sait, ill ne faut pas se le cacher, que la pratique des sports d’hiver est souvent réservée à une élite de la population. Seule une minorité de la population française est partie en vacances au ski au mois de février. Et bien entendu, plus les possibilités d’enneigement vont se restreindre, plus le risque est que la pratique des sports d’hiver se trouve réservée à une toute petite élite qui se ferait déposer en hélicoptère au sommet des pistes des stations de ski. »

3 – « Je voudrais terminer avec la question de l’attractivité et du développement économiques. Très souvent dans le débat public, on a opposé ces deux questions et considéré que les préoccupations pour l’écologie, pour l’environnement étaient une entrave au développement économique.
Ce mouvement des Jeux en 2030 et les préparatifs qui vont y mener peuvent aussi être l’occasion d’une réflexion à l’échelle d’un territoire sur la manière dont nous allons développer économiquement ce territoire demain, en tenant compte de la contrainte écologique. Pas seulement d’ailleurs de la contrainte de l’enneigement en moins, mais également de la contrainte qui va peser sur les ressources en eau, des contraintes qui vont peser face aux événements extrêmes. Et à mon avis, le grand défi écologique de ces Jeux, c’est de pouvoir nous réunir pour nous projeter vers l’avenir, vers 2050 et au-delà.
Quel va être au fond le modèle du développement économique dans les Alpes du Sud pour le XXIᵉ siècle ? Comment va-t-on organiser la coopération entre les acteurs de haute montagne, de moyenne et de basse montagne et les acteurs de la cause ? Comment va-t-on organiser cette coopération en matières touristique et sportive ? »
FAIRE DES ALPES DU SUD UN MODÈLE POUR LE MONDE
« L’organisation de ces Jeux permet d’ouvrir un gigantesque chantier : voir comment, demain et certainement à l’horizon 2050, nous pouvons mettre la durabilité non pas comme un obstacle au développement économique de la région, mais au contraire comme un socle commun, pilier de développement économique. L’exposition fournie par les Jeux olympiques sera un atout précieux.
Parce que grâce à cette exposition, si nous menons cette réflexion en amont, nous allons pouvoir faire la démonstration au monde entier de la durabilité, à la fois des sports d’hiver, mais aussi de la durabilité d’un modèle et d’un développement économique de la montagne qui tienne compte de cette contrainte climatique et sur l’eau.
Vis-à-vis de la transition thématique et écologique, nous avons souvent tendance à imaginer que ce sont des plans sur la comète, de grands discours et des incantations, parfois culpabilisatrices, dont nous ne voyons pas toujours le sens ni l’intérêt. Elle est souvent présentée dans le débat public comme une liste d’efforts à fournir, de sacrifices à consentir, de renoncements à accepter, de coûts supplémentaires à porter. Une liste de choses dont personne n’a envie.
Tout l’enjeu, si nous voulons réussir cette transition, à la fois au niveau de la France mais à l’international, est de pouvoir montrer concrètement pourquoi et comment nous l’avons atteint. Parviendra-t-on à se projet sur l’avenir ? À se projeter nous-mêmes ?
Mais au-delà, à transmettre un message d’espoir et de confiance pour toutes les autres nations ? Et qui vont se dire : ‘S’ils sont arrivés dans les Alpes du Sud, alors nous pouvons nous aussi nous en inspirer et nous pouvons trouver un modèle de durabilité qui va combiner l’activité économique et la vie des gens qui habitent la région avec ses impératifs climatiques’. »
Propos recueillis par B.G.
SUR LE MÊME SUJET








![[Vox Méridional]Obsèques de Mehdi Kessaci : un adieu intime, un cri d’alerte pour une ville sous pression.](https://lemeridional.com/wp-content/uploads/2025/11/2019-12-09.jpg)