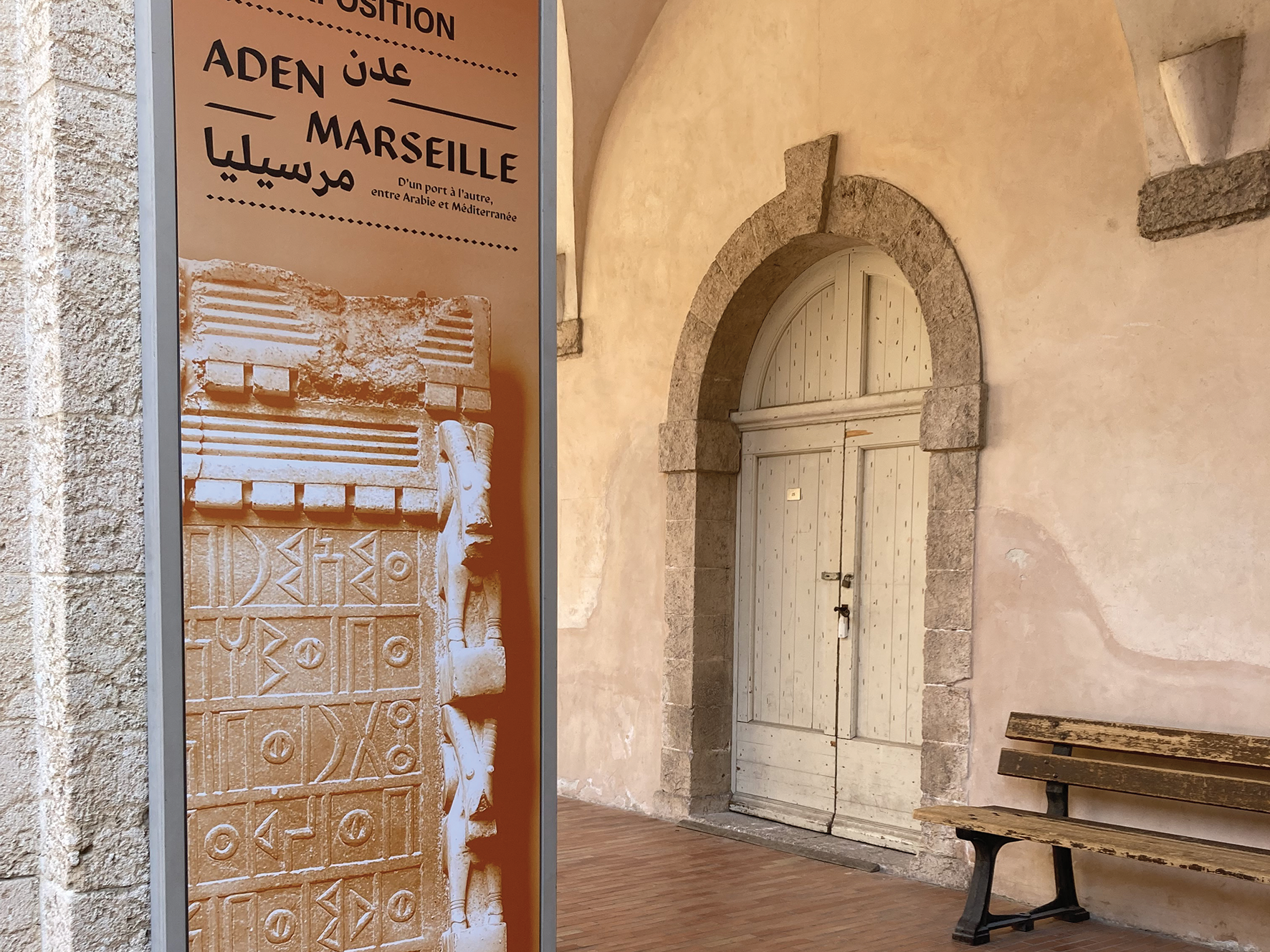La fermeture des Galeries Lafayette et le départ de la cité judiciaire pourraient transformer l’hyper-centre en désert commercial. Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP, monte au créneau : abandonner ces mètres carrés stratégiques serait une catastrophe économique. Il appelle à un sursaut collectif pour éviter que le centre-ville de Marseille ne devienne la plus grande friche commerciale du pays.
Marseille est-elle en train de perdre son cœur ? C’est un scénario que personne ne veut voir se concrétiser. Et pourtant, sans décision forte, « notre plus grand risque, c’est d’avoir la plus grosse friche commerciale du pays au cœur de la deuxième ville de France », alerte Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence, dans un long plaidoyer sur l’état du centre-ville marseillais. L’effondrement commercial du centre-ville n’est plus un spectre, mais une réalité en marche.
La fermeture des Galeries Lafayette fin 2025 sonne comme un coup de semonce. Ce départ laisse derrière lui 22 000 m² de surface vide, un espace qui vient s’ajouter aux 48 000 m² du Centre Bourse, déjà fragilisé par la montée de la vacance commerciale de la galerie qui atteint aujourd’hui 25%, contre 33% il y a un an, malgré les efforts de redynamisation.
Une hémorragie commerciale qui s’accélère
Ce n’est pas qu’un simple mouvement de repli d’une enseigne, mais une menace qui plane sur l’écosystème commercial de l’hyper-centre. « Quand 22 000 m² se vident sur un total de 48 000 m², cela fragilise l’ensemble du centre commercial. Nous ne sommes pas à l’abri d’un effet domino », prévient Jean-Luc Chauvin, interrogé sur ce sujet, lors de ses voeux à la presse. La Fnac serait sur le départ…
La mutation du commerce, entre essor du e-commerce et concurrence des zones commerciales en périphérie, accélère le repli des enseignes. Zara prévoit de fermer 120 magasins en France en 2025. Marseille pourrait être concernée, aggravant encore la situation.
Comme si cette hémorragie commerciale ne suffisait pas, une autre menace plane : le départ programmé de la cité judiciaire vers Arenc. Une décision actée sous l’ère d’Éric Dupond-Moretti, l’ancien Garde des Sceaux, malgré une levée de boucliers des acteurs économiques et judiciaires. Cet exil administratif pourrait sonner le glas de 300 commerces et priver l’économie locale de 18,3 millions d’euros de chiffre d’affaires annuels, d’après une étude validée par l’Insee et l’Agam. Et encore, sans compter l’impact des justiciables et auxiliaires de justice.
« De Paris, il est impossible d’anticiper ces problèmes techniques et financiers. Quatre fonctionnaires dans un bureau à Paris ne peuvent pas décider seuls de l’avenir de notre territoire. L’erreur locale, c’est de ne pas avoir proposé une alternative plus viable », ajoute Jean-Luc Chauvin, sans remettre en cause la nécessite d’une infrastructure moderne pour les besoins de la justice.

À lire aussi
Un projet mal calibré à Arenc
Le projet d’Arenc, en plus d’être un non-sens économique, selon lui, souffrirait d’un défaut de conception majeur. « L’État n’avait même pas réalisé que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne permettait pas la construction de la tour prévue. Il a fallu notre intervention pour rappeler qu’un projet de plus de 100 millions d’euros impose une étude d’impact obligatoire. »
Résultat : le préfet a commandé une analyse indépendante confirmant les risques. Autre écueil : le budget. « L’estimation de 350 millions d’euros est totalement aléatoire », affirme-t-il.
Construire en zone inondable à Euroméditerranée engendrerait des surcoûts massifs. « Il suffit de voir les problèmes d’inondations rencontrés par la tour CMA CGM, dont le parking inférieur est régulièrement sous l’eau, pour comprendre que les coûts exploseront. »
Le ministre à l’origine du projet n’est plus en poste, son successeur n’a donné aucune garantie ferme. Un revirement politique ou une contrainte budgétaire pourrait tout remettre en cause. « Ce ne serait pas la première fois qu’un projet d’envergure est abandonné après des années d’études et des millions investis », rappelle Jean-Luc Chauvin, citant l’exemple du canal Rhin-Rhône.
Une étude pour ancrer la cité judiciaire au Centre Bourse
Face à ce péril, les acteurs économiques poussent pour l’installation de la cité judiciaire au Centre Bourse afin d’éviter la formation d’une friche urbaine massive. « Nous allons proposer aux collectivités et à l’État une étude de redynamisation du centre-ville, incluant une stratégie claire et des mesures concrètes pour attirer entreprises et commerces. En parallèle, nous lançons une étude de faisabilité pour l’installation de la cité judiciaire sur le site des Galeries Lafayette. Nous avons une opportunité unique d’éviter une catastrophe économique. »
Sur le papier, cette solution présente plusieurs avantages. L’espace ne manque pas : avec 22 800 m² libérés par les Galeries Lafayette et les 48 800 m² du site, les besoins de la cité judiciaire (40 000 m²) seraient couverts. Contrairement à Arenc, où tout serait à bâtir, le parking et les infrastructures existent déjà, réduisant coûts et délais. Une livraison dès 2029-2030 serait envisageable, contre 2035-2036 pour le projet d’Arenc, exposé à de nombreux recours.
Surtout, la facture serait moins salée : 350 à 500 millions d’euros pour une construction neuve contre un coût deux à trois fois inférieur pour une simple réhabilitation. « Car il n’est pas nécessaire de raser le bâtiment. Il s’agit d’un projet de réaménagement pour adapter les locaux aux besoins des magistrats et des professionnels de la justice », qui offriraient, en prime, une vue dégagée sur les jardins des Vestiges et le musée de Marseille, un cadre unique en plein centre-ville.

Tiers lieux urbain, Primark, zone franche… d’autres options en débat
À cette proposition, Sébastien Barles, élu écologiste, oppose une autre vision. Il imagine transformer le Centre Bourse en un tiers-lieu dédié à l’innovation sociale et environnementale. « Cette verrue des années 70 pourrait devenir la plus grande vitrine de l’innovation sociale et environnementale en France. »
Valorisation des produits locaux, économie circulaire, participation citoyenne, culture… Un laboratoire du Marseille de demain, loin des logiques purement commerciales. Sauf que Primark lorgnerait également sur le site…
Face à cette dévitalisation annoncée, la Métropole tente aussi de réagir. Martine Vassal a annoncé vouloir installer le siège de la Métropole dans l’actuel palais de justice une fois son déménagement acté.
Grand Central, qui accueille des entreprises et médias, contribue déjà à la redynamisation du centre-ville, et une zone franche urbaine est toujours à l’étude. Mais ces mesures ne suffisent pas à enrayer la dynamique de déclin.
L’urgence d’un sursaut politique collectif
L’équation est connue : sans une stratégie claire, le centre-ville de Marseille continuera de s’effondrer. Jean-Luc Chauvin en appelle à une mobilisation générale des collectivités.
L’enjeu ? Définir une vision à long terme avec des choix clairs sur les activités économiques, administratives et commerciales, ainsi que des mesures fiscales attractives pour ramener entreprises et investisseurs au cœur de Marseille. « Nous avons l’expertise pour mener une étude approfondie sur l’avenir commercial et économique du centre-ville, comme nous l’avons déjà fait pour Aix-en-Provence et Salon-de-Provence. »
Ailleurs, les pouvoirs publics expérimentent déjà des solutions. L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) accompagne des projets de revitalisation pour éviter la désertification commerciale en périphérie. Pourquoi ne pas appliquer ces méthodes au centre-ville marseillais, où l’urgence est encore plus grande ?
Si un projet alternatif voit le jour sans répondre aux besoins réels, les élus devront assumer leurs choix. Une préemption n’est pas exclue, estime Jean-Luc Chauvin, s’il s’agit d’empêcher la formation d’une friche de 48 000 m² dans le centre-ville de Marseille qui ne peut plus attendre. « Rien ne sera véritablement acté tant que les travaux ne seront pas engagés », tranche, combattif, le président de la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine.
Narjasse Kerboua
POUR ALLER PLUS LOIN








![[Vox Méridional]Obsèques de Mehdi Kessaci : un adieu intime, un cri d’alerte pour une ville sous pression.](https://lemeridional.com/wp-content/uploads/2025/11/2019-12-09.jpg)